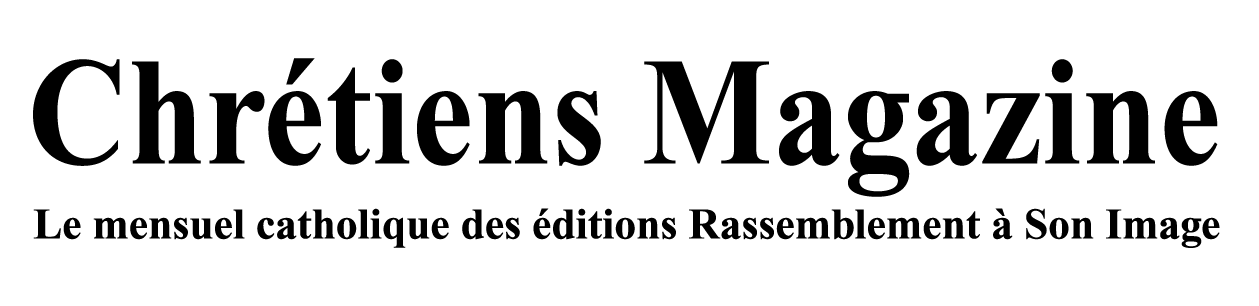Je fis mon service militaire à dix-huit ans. Je fus appelé à Paris. Pour la première fois de mon existence, je vivais parmi des hommes et des femmes qui ne croyaient en rien. Parmi les trente soldats de notre chambrée, j’étais le seul à aller à la messe le dimanche.
C’est dans cette situation que je commençais à douter : car, en fait, mes camarades étaient sincères et sympathiques. Et pourtant, ils ne se souciaient ni de l’Église ni de la religion. On pouvait donc vivre aussi sans croire. Et d’ailleurs pourquoi détiendrais-je à moi tout seul la vérité, pourquoi les autres se tromperaient-ils ?
Je perdis peu à peu la confiance et la foi. Les « ténèbres » m’envahirent. Mais Dieu me donna une lumière dans la nuit.
J’avais une tante que j’aimais beaucoup, tante Thérèse. Elle était infirmière et la bonté incarnée. Elle ne s’était pas mariée. Silencieuse et discrète, elle avait aidé durant toute sa vie d’innombrables hommes et femmes dans leurs détresses morales et physiques.
J’utilisai une permission pour aller la voir. Elle habitait dans un petit bourg aux environs de Paris.
L’après-midi, j’allai me promener tout seul et restai un moment assis sur le parapet d’un pont qui traversait une jolie rivière. Un clochard d’un certain âge arriva et s’arrêta près de moi. Tout d’un coup, il montra du doigt la maison de ma tante :
« Tu vois la petite maison, là-bas, dit-il plein d’enthousiasme, eh bien, c’est là qu’habite la femme la meilleure de tous les environs. Elle ne possède pratiquement rien mais elle fait tout pour aider des gens comme nous. »
A cet instant, je compris que ma tante était de loin le meilleur des êtres que je connaisse – et elle était une chrétienne profondément croyante. Une foi de laquelle émane une telle force d’aimer n’est-elle pas vraie ? C’est ainsi que je trouvai à nouveau le chemin de la foi.
Notre foi
Je crois en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort, et a été enseveli ;
est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts ;
est monté aux cieux,est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit ;
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints ;
à la rémission des péchés ;
à la résurrection de la chair ;
à la vie éternelle. Amen.
Que nous dit la Bible à propos du mystère de Dieu ?
Dieu est Amour : le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont UN.
Pourquoi Dieu permet-il cela ?
Un ouvrier spécialisé américain, Max Ellerbusch, se souvient :
C’était un vendredi plein d’agitation, six jours avant Noël, en 1958. J’étais dans l’atelier d’électricité et y travaillais fébrilement pour pouvoir passer tranquillement les jours de fête en famille. Soudain, le téléphone sonne et une voix à l’autre bout du fil me dit que notre fils de cinq ans, Craig, vient d’être écrasé par une voiture.
Il y avait beaucoup de monde autour de Craig ; lorsque j’arrivai, tous reculèrent. Craig était allongé au milieu de la route et ses cheveux blonds et bouclés ne semblaient même pas décoiffés.
Il mourut l’après-midi même à l’hôpital des enfants.
L’accident était arrivé au croisement près de l’école. La voiture avait surgi si rapidement que personne ne l’avait vue venir. Un élève avait juste eu encore le temps de crier, de faire un signe de la main et de sauter sur le côté pour sauver sa propre vie. La voiture n’avait même pas freiné.
Ma femme Grâce et moi-même quittâmes la clinique et rentrâmes à la maison par les rues décorées pour Noël. Nous n’arrivions pas du tout à réaliser ce qui était arrivé et, cela, jusque dans la soirée. Mais lorsque je passai à côté du petit lit vide, je pris conscience de la réalité. Tout à coup, je me mis à pleurer. Pas seulement devant ce lit vide, mais devant l’absurdité de la vie, tout simplement.
De nos quatre enfants, Craig était celui qui nous avait le plus aidé à assumer les soucis de notre vie quotidienne. Bébé, il souriait si gaiement à la ronde que les gens s’arrêtaient souvent près de son landau pour le regarder. Lorsque nous rendions visite aux uns ou aux autres, c’était déjà Craig qui, du haut de ses trois ans, disait à notre hôtesse : « Vous avez une belle maison ! » Si on lui offrait quelque chose, il en était ému aux larmes et s’empressait de l’offrir au premier enfant venu qui l’enviait.
Quand un tel enfant doit mourir, quand une telle vie peut être anéantie en l’espace d’une minute, alors la vie n’a pas de sens et la foi en Dieu est une illusion – telles étaient mes pensées pendant que je me tournais et retournais dans mon lit, dans la nuit qui suivit ce vendredi fatal.
Le lendemain matin, mon désespoir et ma profonde détresse avaient trouvé une cible. Je sentais monter en moi une haine aveugle à l’égard de celui qui nous avait fait cela ! La police l’avait entre-temps arrêté à Tennessee. Il s’appelait Georges Williams et n’avait que quinze ans.
La police avait appris qu’il venait d’un foyer disloqué. Sa mère travaillait en équipe de nuit et elle dormait pendant la journée. Ce vendredi-là, il avait séché les cours, il avait pris à sa mère – pendant qu’elle dormait – les clés de la voiture et avait descendu la rue à tombeau ouvert.
J’avais l’impression que toute ma colère face à ce coup aveugle du destin se concentrait sur le nom de Georges Williams. J’appelai notre avocat et lui demandai de l’attaquer le plus sévèrement possible en justice : « Essayez d’obtenir qu’il soit traité comme un adulte. Les tribunaux pour enfants ne sont pas assez sévères ! »
Tel était mon état d’esprit lorsque se produisit ce qui devait changer complètement ma vie. Je ne peux pas l’expliquer, je peux seulement décrire ce qui arriva.
Tard dans la nuit de samedi à dimanche, je faisais les cent pas dans la petite pièce attenante à notre chambre à coucher, les poings appuyés sur les tempes. Je me sentais horriblement mal. j’avais des vertiges, je n’en pouvais plus, j’étais fatigué, tellement, tellement fatigué. « Mon Dieu, priai-je, montre-moi pourquoi cela devait arriver ! »
Exactement à cet instant-là, entre deux pas littéralement, ma vie fut transformée. Dans la clarté intérieure de cet instant, j’eus soudain la certitude que cette vie n’avait qu’un seul but, un but tout simple : elle ressemblait à une année scolaire durant laquelle il y aurait une seule matière au programme : l’amour.« Oh. Craig ! pensai-je tout haut, petit Craig, tu as beaucoup appris durant tes cinq courtes années. Comme tes progrès étaient rapides ! Comme tu passas vite dans la classe supérieure ! »
Lorsque j’ouvris la porte de notre chambre à coucher, Grâce était assise toute droite dans son lit. Elle ne lisait pas, elle ne faisait rien. Elle regardait fixement devant elle, comme elle l’avait fait presque sans arrêt depuis vendredi après-midi.
Je pris sa main et essayai de lui dire que le monde n’était pas dominé par un hasard aveugle, que la vie avait un sens, que la souffrance sur cette terre n’était pas une fin en soi et conduisait à un bonheur qui se situait bien au-delà de nos espoirs les plus fous.
« Ce soir, lui dis-je, Craig n’a plus besoin de nous. Mais quelqu’un d’autre a besoin de nous : c’est Georges Williams. C’est Noël. Peut-être n’y aura-t-il pas de cadeau pour lui en prison si nous ne lui envoyons rien. »
Grâce écoutait ; elle me fixait du regard, silencieuse. Soudain, elle éclata en sanglots : « Oui, dit-elle, c’est vrai. C’est la première chose vraie depuis la mort de Craig ! »
Et ce fut bien ainsi. Georges se révéla être un garçon intelligent mais solitaire et perturbé. Il avait autant besoin d’un père que moi d’un fils. Il reçut son cadeau de Noël et sa mère, une boîte remplie de bons petits gâteaux de Noël de Grâce. Nous demandâmes sa mise en liberté. Elle nous fut accordée quelques jours plus lard ; notre maison devint le deuxième foyer de Georges.
Il vient maintenant, après l’école, travailler avec moi à l’atelier ; aux repas, il se retrouve avec nous autour de la table de la cuisine. Il est devenu un grand frère attentif pour Diane, Michaela et Ruth-Carol.
Réf. Aus Was sic mit Gott erlebten – Berichte aus unseren Tagen, Christliches Verlagshaus Stuttgart.
Qui est Jésus ?
Il est le Fils de Dieu devenu homme pour nous.
L’un d’entre nous
C’était en Italie, en 1950. Le vieux cardinal de Naples ne savait plus que penser. Il en avait déjà tellement vu et entendu, mais une chose pareille !
Un jeune prêtre est assis devant lui, dans son bureau. Il lui demande l’autorisation de pouvoir devenir vagabond : il veut vivre dans la rue, avec les gamins sans abri de Naples.
Le vieil homme n’arrive pas à comprendre un souhait pareil. Il connaît la situation de Naples : 200000 chômeurs, et tous ces garçons qui traînent dans les rues parce que leurs parents sont au chômage et ne peuvent pas les nourrir. Ils vivent de vols, parfois de trafic de drogue et de mendicité. Ils dorment dans n’importe quel petit coin. Ils ressemblent à des chats sauvages et craignent la police.
Ce jeune prêtre, Mario Borelli, veut les aider, leur donner un toit, du pain et un peu de chaleur humaine. Cela, le cardinal peut le comprendre. Mais pourquoi ce prêtre veut-il pour autant vivre lui- même comme un vagabond ? Mario sait très bien pourquoi : « Si je vais à la rencontre de ces garçons en tant que prêtre, ils me cracheront à la figure. Ils sont terriblement méfiants. »
Le cardinal réfléchit : « Donnez-moi dix jours. »
Dix jours plus tard, le prêtre reçoit l’autorisation du cardinal. Mario se promène dans les rues, une vieille casquette de travers sur la tête, ses habits en guenilles, un mégot au coin de la bouche. Il mendie, collectionne les vieux bouts de cigarettes et devient un sans-abri parmi d’autres.
Peu à peu, il gagne le cœur de ces garçons. Il devient même assez vite le meneur d’une bande. Lorsqu’il trouve un abri primitif, ces garçons le suivent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont fascinés. Ce Mario a quelque chose auquel ils ne peuvent pas résister. Ils n’ont pas de mots pour l’exprimer car ils n’ont jamais rien vécu de semblable. Comment peuvent-ils savoir que l’Amour, c’est cela ?
Peut-être pouvons-nous maintenant mieux comprendre pourquoi Dieu s’est fait homme. Il voulait être l’un d’entre nous, pour nous sauver. « Dieu avec nous », c’est cela Jésus.
Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix ?
Jésus est mort sur la croix pour racheter nos péchés.
L’amour poussé jusqu’à l’offrande de soi
À Auschwitz, en 1941.
Un prisonnier s’est enfui du camp de concentration. Le soir, le chef de camp Fritsch s’adresse aux prisonniers : « Le fuyard n’a pas été retrouvé ! crie-t-il. Dix d’entre vous vont mourir pour cela au cachot. » Il s’approche de la première rangée et fixe chacun des prisonniers d’un regard pénétrant. Puis il lève la main et montre un homme du doigt : « Celui-là, là ! »
Le prisonnier sort du rang, blanc comme de la craie.
« Celui-là, et celui-là, et celui-là… » Ils sont dix. Dix condamnés à mort. L’un d’eux se lamente : « Oh, ma pauvre femme et mes enfants ! »
Tout à coup, c’est l’inattendu. Un prisonnier sort des rangs et vient se mettre debout devant Fritsch. Le chef de camp saisit son revolver : « Halt ! Que me veut ce cochon de Polonais ? » L’homme répond tranquillement :
« Je voudrais mourir à la place de ce condamné !
– Qui es-tu ? »
La réponse est brève : « Un prêtre catholique. »
Un moment de silence. Fritsch prend enfin sa décision et dit d’une voix enrouée : « D’accord ! Va avec eux ! »
C’est ainsi que mourut le franciscain Maximilien Kolbe. Il n’avait que quarante-sept ans : il voulait conquérir le monde par l’amour. Et il savait que celui qui est prêt à donner sa vie pour ses amis aime plus que quiconque.
Jésus est-il ressuscité des morts ?
Oui, il est ressuscité et nous ressusciterons aussi.
Le chien-théologien
Le grand malade saisit la main du docteur :
« J’ai si peur de mourir. Dites-moi donc, docteur, qu’est-ce qui m’attend après la mort ? À quoi va ressembler l’autre côté ?
Je ne sais pas, répondit le docteur.
Vous ne le savez pas ? » murmura le mourant.
Au lieu de répondre, le docteur ouvrit la porte qui donnait sur le couloir. Un chien entra, sauta sur le docteur et manifesta de mille et une façons toute la joie qu’il avait à retrouver celui qui était son maître.
Le docteur se tourna alors vers le malade et dit : « Vous avez observé le comportement du chien ? Il n’était jamais venu dans cette pièce, il n’en connaissait pas les occupants. Mais il savait que son maître était de l’autre côté de la porte et il est entré joyeusement dès que la porte s’est ouverte. Voyez-vous, je ne sais rien de plus sur ce qui nous attend après notre mort, mais cela me suffit de savoir que mon Seigneur et Maître se trouve de l’autre côté. C’est pourquoi, le jour où la porte s’ouvrira, je passerai de l’autre côté dans une joie profonde. »
Pourquoi devons-nous vénérer Marie tout particulièrement ?
Parce qu’étant Mère de Jésus, elle est aussi Mère de Dieu.
Priez pour nous, pauvres pécheurs
L’histoire suivante a été racontée par un sous-marinier pendant la seconde guerre mondiale.
La journée commence tranquillement. La mer est calme. Aucune présence ennemie à l’horizon. Mais tout à coup, la sirène d’alarme retentit. Le commandant donne tout de suite l’ordre de plongée : « Ennemi en vue ! »
Très peu de temps après explosent les premières grenades sous-marines. Nous sommes assis dans le carré, en alerte. Nous nous attendons à être touchés. Nos visages sont graves et pâles. Chacun d’entre nous sait que cela serait notre fin.
Nous entendons le grondement des détonations. Le sous-marin file à grande vitesse sous l’eau. Le grand Hein est assis en face de moi : il sort soudain un chapelet de sa poche, il prie. C’est la première fois que l’un d’entre nous prie devant les autres… Mais personne ne rit !
« Dis donc, Hein, donne-m’en aussi un bout, je suis catholique ! » Quelle impression bizarre, cette main d’homme calleuse qui demande à avoir un petit bout de chapelet… Hein arrache une dizaine et la donne à son voisin.
Dehors, le combat continue, déchaîné.
« Donne-m’en un bout aussi !
– À moi aussi ! »
Hein n’a plus qu’une dizaine dans la main, et la croix. Cinq hommes prient, et personne ne se moque d’eux.
« Dis, donne-moi la croix, je suis protestant. »
Hein tend la croix.
Nous venions d’oublier pendant cinq minutes le déchaînement de la bataille. Après une heure environ, nous pûmes échapper à l’ennemi.
Qu’est-ce que l’Église ?
L’Église est la communauté de ceux qui croient au Christ.
« Crois en Jésus-Christ »
Torturé pour le Christ. Ainsi s’appelle le livre du pasteur baptiste Richard Wurmbrand, originaire de Roumanie.
Il raconte comment, en 1948, il fut agressé dans la rue par des communistes. Ils l’enfermèrent car il clamait sa foi en Dieu à qui voulait l’entendre.
Peu de temps après, ils arrêtèrent aussi sa femme. Michael, leur fils de neuf ans, resta tout seul. Le jeune garçon dut se battre durement pour survivre, il devint tellement amer qu’il en perdit la foi.
Deux ans plus tard, on lui permit d’aller voir sa mère. Il se rendit à la prison et la vit derrière des barreaux. Des fonctionnaires de police étaient présents. Ils avaient strictement interdit à la mère de Michael de parler de religion.
Michael reconnut à peine sa mère tant elle avait souffert de mauvais traitements. Ses premiers mots furent : « Michael, crois en Jésus-Christ ! » Absolument furieux, les gardiens l’arrachèrent à son fils et l’emmenèrent.
Michael pleura lorsqu’il vit sa mère si violemment repoussée, avant même qu’il ait pu lui dire ne serait-ce qu’un seul mot. Mais il n’oublia jamais ce que sa mère avait eu le temps de lui dire : « Michael, crois en Jésus ! » Et il retrouva le chemin de la foi.
Il y a plus de deux milliards de chrétiens baptisés dans le monde entier. Ils croient en Jésus-Christ. Ils sont devenus fils de Dieu par le baptême. Malheureusement, les chrétiens sont divisés en plusieurs confessions. Il y a les anglicans, les catholiques, les chrétiens orthodoxes et les protestants.
Prions souvent : « Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit afin que nous soyons UN. »
Qui est le chef visible de l’Église ?
C’est le pape, à Rome, le successeur de l’apôtre Pierre.
Le pape et la mère supérieure
La sœur portière en perdit presque le souffle. Le pape en personne était devant la porte et attendait patiemment après avoir sonné. Jean XXIII voulait rendre visite à un prêtre malade qui se trouvait à l’hôpital du Saint-Esprit, à Rome.
La sœur appuya sur le bouton. Le pape entra et elle partit en courant prévenir la mère supérieure. Celle-ci arriva, très émue. Un visiteur d’un si haut rang n’était encore jamais venu à l’hôpital. Elle voulut se présenter tout de suite et dit : « Je suis la supérieure du Saint-Esprit. »
Le pape sourit d’un air entendu et répondit : « Et moi, je n’en suis pas encore là, je ne suis que le représentant de Jésus-Christ. »
Que se passe-t-il après la mort ?
Les âmes des justes vont au ciel, le plus souvent après un temps de purification.
Pendu deux fois
Roger Warren, un tisserand originaire du comté anglais de Lancaster, fut condamné au XVIe siècle à être pendu parce qu’il avait aidé des prêtres catholiques et les avait hébergés.
On lui mit la corde au cou mais lorsqu’on éloigna l’échelle, la corde cassa et Warren tomba à terre. Il reprit connaissance après quelques instants. Il se mit à genoux et pria en silence. Il regardait le ciel et son visage rayonnait de joie.
Le capitaine lui proposa une fois encore la liberté – à condition qu’il abjure sa foi. Warren se leva et dit : « Je suis le même qu’avant, je suis toujours prêt à mourir pour Jésus-Christ. Faites de moi ce que vous voudrez. » Et il se dépêcha de remonter à l’échelle.
« Mais, qu’est-ce qui lui prend ? cria le capitaine. Pourquoi est- il si pressé ? » Warren dit : « Si vous aviez vu ce que je viens de voir, vous auriez aussi hâte que moi de mourir. » Le bourreau lui passa une corde plus solide autour du cou et retira l’échelle. Ainsi mourut le martyr Roger Warren.
Qu’arrive-t-il à ceux qui meurent sans se repentir d’avoir gravement offensé Dieu ?
Ils entrent dans la tourmente éternelle de l’enfer.
Il ne revint pas
Deux poissons se promènent dans la mer. Tout à coup ils voient juste devant eux un beau petit ver. L’un des poissons dit à l’autre : « Tu vois, le ver est accroché à un hameçon. L’hameçon est accroché à un fil. Le fil à une canne. Et un homme tient cette canne. Si l’un d’entre nous mange le ver, l’hameçon se plante dans sa gueule, l’homme s’en empare et le pauvre poisson atterrit dans la poêle à frire. »
L’autre poisson dit alors : « Ah ! Ah ! Cette histoire, ma grand- mère la racontait déjà quand j’étais petit. Je ne crois pas à de telles sornettes. Comment peut-on affirmer une chose pareille ? Aucun poisson n’est encore revenu de la poêle pour raconter tout cela ! Si tu ne veux pas manger ce bon petit ver, eh bien moi, je vais le faire. » Ce qu’il fit. Il finit, lui aussi, dans la poêle à frire. Et comme les autres, lui non plus ne revint pas pour raconter son histoire…
Beaucoup de personnes disent : « Nous ne savons rien de l’enfer ! Personne n’en est encore revenu pour nous dire à quoi il ressemble. »
C’est vrai ; mais Jésus nous a mis en garde contre le feu éternel. Ne prenons pas cela trop à la légère ; essayons plutôt de vivre selon la parole du Christ.
Qui va réussir l’examen de passage du Jugement dernier ?
Celui qui, dans l’amour, aide ceux qui souffrent.
Le roi et le paysan
Cette histoire se situe aux débuts du Royaume d’Espagne.
Le roi Richard alla un jour à la chasse. Un orage le surprit au beau milieu de la forêt et il se retrouva complètement seul. Le jour tomba et il chercha le chemin qui le ramènerait au palais. Il ne le trouva pas. Il passa toute la nuit à la belle étoile. Il faisait froid. Tenaillé par la faim, il errait dans cette forêt immense.
Trempé jusqu’aux os et épuisé, il tomba enfin, tôt le matin, sur une ferme isolée. Il frappa à la porte mais personne ne répondit. Il frappa à nouveau. Le roi, désespéré, essaya d’ouvrir. La porte n’était pas fermée à clef ; elle grinça.
Un homme se leva soudain de la table de la cuisine et se mit à crier : « Eh ! Espèce de fichu voyou, tu viens voler, hein ! Vite, file, sinon je lâche les chiens. »
Le roi le supplia, mais le paysan n’en fut que plus furieux. Il finit par frapper le roi en plein visage et lui claqua la porte au nez. Mais le roi, grâce à l’aide de gens qui passaient par là, retrouva le chemin de son palais.
Trois jours plus tard, il convoqua le paysan. Celui-ci se posa bien des questions : « Pourquoi dois-je, moi, aller voir le roi ? Je ne lui ai rien fait ! Je ne le connais même pas. »
Il dut se présenter tout seul devant les princes du Royaume rassemblés. Le roi portait ses vêtements d’apparat, il tenait son sceptre à la main et avait sa couronne sur la tête. Il regarda longuement, et sans rien dire, le paysan tout tremblant. Puis il rompit le silence : « Me reconnais-tu ? »
Le paysan fut tellement retourné par cette parole qu’il mourut peu de temps après.
Cette parole, nous l’entendons aussi le jour du Jugement dernier : « Me reconnais-tu ? J’ai eu faim, j’étais malade, j’étais étranger. » Espérons que le Christ, notre Roi à tous, n’aura à aucun d’entre nous : « Va au feu éternel ! Ce que tu n’as pas fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que tu ne l’as pas fait » (Mat. 25)
Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles !
Amen.
Pourquoi Jésus nous a-t-il appris une prière si courte ?
Pour que nous puissions la prier de tout cœur.
Ni le cheval ni la selle
Voici, à ce propos, une histoire vraie de saint François de Sales. François de Sales était évêque, un très bon évêque. Il vécut il y a environ quatre cents ans.
Un jour, il arriva à cheval dans un village. Il y rencontra un paysan. Celui-ci dit :
« Bonjour, Monseigneur ! Je dois vous dire quelque chose. Savez-vous que j’arrive à prier sans penser à quoi que ce soit d’autre ?
– C’est formidable, répondit François. Je n’ai encore rencontré personne qui y soit parvenu, tu mérites une récompense. Écoute ! si tu réussis à prier tout le Notre Père sans penser à quoi que ce soit d’autre, je te donnerai mon beau cheval. »
Le paysan se réjouit beaucoup et se mit tout de suite à prier : « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite… Est-ce que j’aurai la selle aussi ou seulement le cheval ? » demanda-t-il tout d’un coup.
L’évêque se mit a rire : « Hélas, hélas ! dit-il, ni le cheval ni la selle. » Le paysan comprit qu’il avait tout perdu. Il n’avait même pas pu dire cette prière si courte sans se laisser distraire !
Pourquoi pouvons-nous dire à Dieu « Notre Père » ?
Parce que Dieu nous a créés et nous a adoptés comme ses enfants.
Au château de Versailles
Le roi de France, Louis XV, avait une fille qui était très orgueilleuse. Un jour, la princesse ne retrouva plus un petit collier en or. Sans raison, elle accusa sa servante.
Celle-ci se défendit : « Madame, vous êtes très injuste à mon égard. » La princesse, fâchée, s’écria : « Que vous permettez- vous ? Ne savez-vous pas que je suis une fille de roi ? »
La servante répondit tranquillement : « Et moi, je suis même une enfant de Dieu ! »
Pourquoi disons-nous « aux cieux » ?
Parce que la toute-puissance de Dieu nous donne l’espoir d’être exaucé.
« Mais enfin, est-ce que personne ne nous entendra ? »
Les perceuses creusaient la roche en crissant. Les ciseaux et les pics martelaient la paroi d’un bruit sourd et cadencé. Tout se déroulait normalement dans la mine. Six mineurs travaillaient dans une galerie basse, déjà assez avancée, trempés de sueur et essoufflés par l’effort.
Ils venaient de finir leur petit-déjeuner et avaient repris leurs perceuses et leurs ciseaux. Farel laissa tomber ses outils de travail :
« Je ne sais pas, murmura-t-il. L’air est un peu bizarre. Vous ne sentez donc rien ?
Oui, l’air ne me plaît pas, à moi non plus ! dit le maître foreur en faisant un petit signe de tête. Nous allons quand même… »
Avant qu’il ait pu finir sa phrase, un craquement épouvantable et une forte explosion ébranlèrent le puits. Puis ce fut le silence et le noir. Seules, quelques lampes de mineurs vacillaient encore dans les ténèbres.
« Nous sommes bloqués par l’effondrement ! balbutia Farel, les lèvres tremblantes.
– Nous sommes tous perdus ! gémit Pierre. Toute la montagne s’est écroulée.
– Ne dis pas d’idiotie, ils viendront nous chercher ! protesta son camarade Marcel.
– Ils doivent venir nous chercher ! Je veux vivre !
– Mais oui, ils ne peuvent pas nous laisser crever comme du bétail ! dit Farel en pleurant. J’ai une famille, une femme et trois enfants !
– Cela peut durer plusieurs jours avant qu’ils n’arrivent ! dit le chef d’équipe. Il haussa les épaules et ajouta d’une voix basse : S’ils arrivent !
– Eh toi, dit Pierre dans un sursaut furieux, qu’as-tu dit ? Tu as dit : s’ils arrivent ?
– Calme-toi, Pierre, tu n’améliores rien en criant ainsi !
– Qu’allons-nous devenir maintenant ? demanda Marcel.
– S’ils ne viennent pas nous chercher, nous mourrons de faim.
– Combien de temps peut-on tenir sans nourriture ?
– Huit jours ! dit l’un.
– Dix, douze ! dirent d’autres.
– Nous allons appeler, donner signe de vie en tapant ! proposa Farel.
– Les équipes de sauvetage sont peut-être déjà assez près de nous.
– Quelle idiotie ! Personne ne nous entend, ici ! répondit le maître foreur. Il faut d’abord que nous, nous les entendions. Et ensuite, cela vaudra la peine de leur donner signe de vie. »
Le temps passait affreusement lentement. Aucun des hommes ne savait s’il était en train de passer des minutes ou des heures dans cet effroyable tombeau. Les lampes commençaient à vaciller. Une lampe après l’autre s’éteignit. Plus aucune lueur ne pénétrait dans ce cercueil vivant.
Au bout d’un certain temps, Pierre se mit à se débattre comme un fou et à se cogner désespérément les poings contre les parois sombres en criant de toutes ses forces. Les mineurs eurent très peur. Ils eurent beaucoup de mal à le maîtriser. Il finit par s’écrouler en gémissant.
Le temps s’écoulait avec une lenteur impitoyable. La faim et la soif commençaient à tourmenter les mineurs. Leurs bouteilles et leurs gamelles étaient vides.
Et toujours ces pensées obsédantes : finiront-ils par nous trouver ? Combien de temps mettront-ils à tomber sur notre galerie ? Si nous pouvions au moins nous faire entendre !
« Mais personne ne nous entend, absolument personne ? gémit Marcel. Mais quelqu’un doit nous entendre !
– Si au moins on pouvait croire en Dieu !… dit Farel, un peu hésitant. Si seulement on pouvait…
– Et puis quoi, alors ? dit Pierre brusquement.
– Eh bien..on pourrait prier, et il nous entendrait !
– Et alors ?
– Et alors il pourrait nous sauver !
– Mais il n’y a pas de Dieu, il n’existe pas. Ce sont seulement des sornettes de curés, murmura Marcel d’une voix sourde.
-Tu crois ? demanda Farel lentement. Enfin…, ce ne sont peut- être pas des sornettes, ces histoires avec le Bon Dieu. Et s’il existe, il doit nous entendre, dit le chef d’équipe comme s’il se parlait à lui-même.
– Peut-être va-t-il même nous sauver ! balbutia Pierre. On devrait quand même essayer de prier.
– Qui sait encore prier ? demanda le maître foreur.
– Autrefois, je connaissais une prière, dit Farel. Mais je ne sais plus que les deux premiers mots : Notre Père.
– Notre Père ? Oui, c’est cela, dirent les autres. Si seulement on savait comment ça continue ! Réfléchissons ! »
Après mûre réflexion, l’un ou l’autre parvint tout de même à se souvenir d’une parole du Notre Père qui sait combien d’heures ils passèrent à cela. Et ils réussirent enfin à reconstituer tout le texte du Notre Père. Ils le redisaient sans cesse, silencieusement, chacun pour soi, puis de nouveau ensemble, aussi recueillis qu’à l’église, suppliant, criant, gémissant, ils répétaient inlassablement la même parole : Notre Père qui es aux deux.
La faim et la soif torturaient les emmurés. De temps en temps, l’un d’eux hurlait dans un accès de désespoir. Puis on entendait de nouveau la grande prière dite par l’un ou l’autre : Notre Père…
Aucun d’eux n’aurait pu dire depuis combien de temps ils étaient bloqués lorsque le maître foreur Farel sortit d’un demi-sommeil en sursautant. Était-ce une illusion de ses sens délirants ou avait-il vraiment entendu frapper et creuser ? « Eh, vous autres ! » dit-il. Sa voix était proche du râle, il balbutiait difficilement.
« Écoutez ! » Les autres perçurent aussi les bruits des outils et les coups dans la roche. « Ils sont là ! Ils sont là ! » parvint à dire Pierre d’une voix enrouée. Et il commença à frapper frénétiquement avec un marteau contre les parois noires. Les autres suivaient son exemple. Puis ils s’arrêtaient un moment pour écouter si une réponse leur parvenait.
Les sauveteurs se rapprochaient, cela ne faisait aucun doute. On entendait de plus en plus fort les coups de marteau dans la roche.
Les derniers obstacles tombèrent. Les sauveteurs déblayèrent les pierres, le charbon et les morceaux de poutres brisées. Un homme s’avança en rampant dans la galerie, l’éclaira et dit :
« Eh oui, eh oui ! C’est vrai, ils sont encore vivants ! »
Des mains se tendirent vers lui. Des infirmiers arrivèrent, allongèrent les hommes qui n’avaient plus la moindre force sur des civières et les sortirent du puits. Des ambulances les emmenèrent à l’hôpital. C’est là qu’ils apprirent qu’ils étaient restés enfermés douze jours et douze nuits. Personne n’espérait plus les retrouver vivants.
« Que vous n’ayez pas perdu la raison dans ce trou noir ! dit le médecin qui les examina.
– Je peux vous dire exactement pourquoi ! répondit le chef d’équipe. Nous avons retrouvé, en bas, la foi en Dieu et nous avons de nouveau appris à dire le Notre Père. Cela, et cela seul nous a sauvés. Sinon, nous aurions perdu tout espoir depuis longtemps ; ou bien nous serions morts ou devenus fous. »
Pourquoi dit-on : « Que ton nom soit sanctifie » ?
Parce que nous adorons la grandeur infinie de Dieu.
Cela s’est fait tout seul
Un professeur américain raconte l’histoire suivante :
Je suis biologiste. Je me penche tous les jours sur les merveilles de la vie, des plantes jusqu’à l’homme, en passant par les animaux. Je m’étonne régulièrement des mystères de la création.
J’ai un ami qui est astronome, il passe de nombreuses nuits derrière son télescope. Il étudie les milliards d’étoiles et de planètes.
Une nuit, il m’emmena dans son observatoire. Il me montra une petite tache claire dans le ciel puis il me dit de la regarder à travers son télescope géant. L’image était époustouflante. La tache blanche apparaissait comme une multitude d’étoiles, petites et grandes, en forme de spirale gigantesque.
L’astronome me dit : « C’est une galaxie avec environ cent milliards de systèmes solaires. » Je me sentis tout petit. J’étais subjugué par l’immensité de la création : « Mais qui a donc créé toutes ces étoiles ? Qui a fait tout cela ? » ne pus-je m’empêcher de demander à mon ami. « Personne ! répondit-il, cela s’est fait tout seul. »
Mon ami, en effet, est athée. Il ne croit pas à l’existence d’un Dieu créateur.
Peu de temps après, je l’invitai à dîner. Un mobile pend au plafond de notre salon : le soleil et toutes les planètes. Mon ami fut confondu d’admiration : « Quelle réussite ! dit-il. Chaque planète suit exactement sa trajectoire autour du soleil. C’est magnifique. Qui a fait cela ? »
Je le regardai en souriant et répondis : « Personne ! Cela s’est fait tout seul. »
Pourquoi disons-nous « Que ton règne vienne » ?
Pour qu’il y ait plus d’amour et de justice sur la terre.
La voiture du pape
Il y a environ quatre millions de lépreux en Inde. Le lépreux est rejeté, il est même souvent chassé de chez lui. C’est pourquoi ceux qui sont touchés par cette horrible maladie font tout pour la cacher.
Mère Teresa de Calcutta voulut vaincre ces préjugés. Elle rêvait d’une « ville de la paix » dans laquelle on aurait guéri les lépreux. Mais elle n’avait, hélas ! pas le moindre sou pour réaliser son rêve.
Un jour, elle apprit que le pape devait venir pour la première fois en Inde. Cette nouvelle la remplit de joie. Le pape, en effet, prit l’avion pour Bombay en 1964. L’enthousiasme de la population dépassa toute attente.
Une firme américaine offrit au pape une extraordinaire voiture blanche dans laquelle il fit le trajet de l’aéroport à Bombay. À la fin de son séjour, il offrit la voiture à Mère Teresa, la mère des pauvres, « pour son infini et inlassable travail d’amour. »
Que faire de cette voiture ? Mère Teresa n’hésita pas. Elle organisa une loterie. La voiture blanche en était le premier prix. Une veuve acheta dix billets dans l’espoir de gagner la belle auto pour son fils. Elle eut de la chance car elle gagna le premier prix. Mais elle réalisa vite à quel point l’entretien de cette voiture était coûteux. Elle la revendit et donna la plus grande partie du prix de vente à Mère Teresa.
C’est alors que le rêve de Mère Teresa devint réalité. Le gouvernement de l’Inde mit à sa disposition un grand terrain près de Calcutta. Avec l’argent de la voiture, elle put y construire plusieurs petites maisons pour les lépreux. Elle y bâtit même un hôpital où beaucoup de malades sont soignés. Et elle organisa des ateliers dans lesquels ceux qui étaient guéris pouvaient apprendre un métier manuel.
C’est ainsi que naquit, grâce au cadeau du pape, toute une ville de l’espérance. Et chacun sait aujourd’hui qu’il y a près de Calcutta, qui est la capitale de la misère, aussi une capitale de la paix où les lépreux ne sont pas méprisés mais respectés, soignés et, pour beaucoup d’entre eux, guéris.
Pourquoi disons-nous : « Que ta volonté soit faite » ?
Parce que Dieu, à travers ses commandements et sa Providence, veut le meilleur pour nous.
Le cantique préféré de Bach
Jean-Sébastien Bach devint aveugle en vieillissant. Un jour, l’un de ses amis lui dit l’arrivée dans la ville d’un ophtalmologue très réputé ; ce dernier serait prêt à l’opérer s’il le désirait.
« Pourquoi pas ! » dit le vieux Bach.
Le jour dit arriva. Mais l’opération ne réussit pas. Quatre jours plus tard, le médecin retira le pansement des yeux de Bach. Sa famille l’entourait et lui demanda : « Vois-tu, maintenant ? » Bach répondit : « Que la volonté de Dieu soit faite ! Je ne vois rien ! »
Tous ceux qui l’entouraient se mirent à pleurer et alourdirent encore le cœur de leur vieux père. Il leur dit alors en les encourageant gaiement : « Chantez-moi plutôt mon cantique préféré : « Que la volonté de mon Dieu soit faite toujours et partout, sa volonté est la meilleure ! » »
Dieu est-il responsable du fait que beaucoup ne mangent pas à leur faim ?
Non, c’est la faute des égoïstes qui ne veulent pas partager.
Le vantard
Une Berlinoise âgée de quarante ans raconte :
Mon mari n’est pas un méchant homme. Il ne boit pas et ne fait rien de mal. Mais il se vante beaucoup. Depuis que je suis mariée, je n’ai jamais connu le calme. Nous vivons sans cesse dans la misère et la pénurie. L’huissier de justice est notre hôte permanent. À chaque fois que l’on sonne à la porte, je me dis : « C’est de nouveau quelqu’un qui vient réclamer de l’argent. » La nuit, je ne peux plus dormir, je me fais trop de soucis. Je pense aux enfants qui, souvent, n’ont pas assez à manger.
Mon mari, certes, ne fait pas partie des hauts salaires. Nous pourrions cependant y arriver. Mais pour en imposer aux autres, il s’est acheté une voiture qui est bien au-dessus de ses moyens. Il n’a pas pu la payer et il s’est endetté. Tous les jours, il va sur son lieu de travail dans sa limousine, comme un directeur général : il veut épater le voisin. Son salaire passe dans l’entretien de sa voiture et il s’endette de plus en plus.
Pendant la pause de midi, il va au restaurant alors que nous n’avons rien à manger à la maison. Notre fils supplie souvent son père : « Papa, vends donc la grosse voiture, elle fera notre malheur ! »
Mais peu lui importe ; il pense seulement à son prestige. Que diraient ses collègues s’il arrivait sans voiture ? Ils se réjouiraient, ils se moqueraient de lui et il ne le supporterait pas. Que nous n’ayons pas une minute heureuse à la maison le laisse complètement froid.
Il existe de tels égoïstes. On les rencontre dans beaucoup de familles et de communautés. Il y a même, dans la grande famille des peuples, des pays riches qui laissent tout au plus quelques miettes de pain aux pays les plus pauvres. Chacun de nous devrait demander à son voisin : « Est-ce que je fais, moi aussi, partie de ces égoïstes ? »
Pourquoi disons-nous : « Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons » ?
Parce que seul celui qui est miséricordieux mérite la miséricorde de Dieu.
Et pourtant il m’a pardonné
La guerre civile faisait rage, sans pitié aucune, sur le sol espagnol. Des églises profanées, des villages en flammes, des cadavres mutilés indiquaient le chemin pris par les communistes.
Les nationalistes aussi se battaient avec un acharnement sans pareil. Quelques-uns d’entre eux venaient de « nettoyer » un village de leurs ennemis. Le combat avait été rude. Ce groupe tomba, au coin d’un mur, sur un communiste gravement blessé dont la poitrine avait été déchiquetée par un éclat d’obus.
Le blessé, l’œil vitreux, regarda la patrouille s’approcher. Puis il leva la main d’un geste faible et balbutia :
« Un prêtre ! Allez me chercher un prêtre !
6 Au diable, canaille rouge ! » jura l’un des nationalistes.
Pourtant, l’un de ses camarades eut pitié du blessé : « Je vais voir si j’en trouve un. »
Il revint sans tarder accompagné d’un prêtre. Celui-ci se pencha avec compassion sur le grand blessé, un très jeune garçon :
« Vous voulez vous confesser ? lui demanda-t-il.
– Oui, je veux me confesser ! dit le soldat d’une voix haletante. Mais dites-moi, vous êtes le curé de ce village ?
– Oui, c’est moi !
– Mon Dieu ! » balbutia le jeune homme.
Le prêtre resta longtemps auprès du mourant. Lorsqu’il rejoignit la patrouille des nationalistes en faction, ses cheveux étaient trempés, son visage blanc comme de la craie : « Frères ! parvint-il tout de même à dire avec difficulté, portez le blessé dans la maison la plus proche afin qu’il ne meure pas sur la route. »
Lorsque les soldats s’approchèrent du jeune homme, celui-ci se souleva un peu et leur fit signe de se pencher vers lui : « Il m’a pardonné ! Il m’a donné l’absolution ! » Il haletait, il ne trouvait plus son souffle.
« Pourquoi ne te pardonnerait-il pas ? C’est son métier, dit l’un des nationalistes.
– Vous ne savez pas ce que j’ai fait ! gémit le mourant. J’ai tué à moi tout seul trente-deux prêtres ! Je les ai poignardés, assommés, étranglés, j’ai tiré sur eux. Dans chaque village, j’ai d’abord été au presbytère. Ici aussi, je l’ai fait. Je n’ai pas trouvé le prêtre, mais j’ai trouvé son père et ses deux frères. Je leur ai demandé où il était. Ils n’ont pas voulu le trahir. Alors, je les ai tués, tous les trois ! Vous comprenez ? J’ai tué le père et les frères du prêtre qui m’a confessé… Et pourtant il m’a pardonné. »
Que veut dire : « Ne nous soumets pas à la tentation » ?
Cela signifie : soutiens-nous dans notre faiblesse afin que nous ne t’offensions pas.
Le billet de banque brûlé
En Afrique, la plupart des gens sont très pauvres. Il y a beaucoup d’enfants abandonnés dans la grande ville d’Abidjan. Leurs parents n’ont rien, ils ne peuvent pas les nourrir. Et c’est ainsi que ces enfants mendient ou volent.
En 1960, un jeune prêtre français, le père Martin, commence à s’occuper de ces enfants. Il loue une maison pour eux. Les jeunes la surnomment vite « Notre maison. »
Un jour, les garçons amènent un nouveau camarade au père Martin. Il vient d’une bande de pickpockets. Le soir suivant, un homme apporte au nouvel arrivé un billet de vingt francs. C’est sa participation, dit-il, à leur dernier vol commun.
Le jeune veut se mettre tout de suite l’argent dans la poche. Puis il se demande tout de même si c’est bien de le faire. Il va voir Paul, le « chef » des garçons au foyer. « C’est de l’argent sale, lui dit Paul, tu n’as pas le droit de le garder. »
Il rassemble les autres garçons et leur demande ce qu’ils pourraient bien faire de ces vingt francs. L’un dit : « Achetons un ballon de foot. » Les autres préfèrent aller au cinéma. Paul, lui, dit :
« Mais cet argent ne nous appartient pas !
– Rendons-le à son propriétaire ! » crie l’un d’entre eux. Mais ils ne le connaissent pas.
Paul prend alors la décision suivante : « C’est de l’argent volé. Je le redis : de l’argent sale. Nous allons le détruire. » Tous sont d’accord. Paul va chercher les allumettes et brûle le billet.
Lorsque le père Martin entend cela, il pense : je n’ai même plus cinq francs pour acheter une natte au nouveau-venu, où va-t-il dormir ? Le lendemain, on offre au père Martin cinq cents francs. C’est inespéré. Les enfants voient dans ce cadeau une récompense : ils ont en effet résisté à la tentation d’empocher cet argent sale.
Le père Martin trouva rapidement du travail pour les garçons les plus âgés. Lorsque l’un d’eux apporta son premier salaire au père, il lui dit tout fier : « Ça, c’est de l’argent propre ! »
Qui peut nous délivrer du mal ?
Le Christ, sauveur de tous les hommes.
« L’internationale » en allemand
Durant la deuxième guerre mondiale, l’Europe a beaucoup souffert sous le joug allemand. Mais il ne faut pas oublier que les Allemands eux-mêmes ont beaucoup souffert de la folie d’Hitler, même après l’effondrement de 1945.
En Russie, le soir de Noël 1946.
Tout est calme dans le camp des prisonniers allemands. La plupart d’entre eux, morts de fatigue à la suite du très dur travail par équipe dans la mine de charbon, se sont allongés sur leur couche. Ils ont remonté sur leur visage leur tenue sale de mineurs pour pouvoir glisser plus vite au pays des rêves, l’un de ces ponts dorés qui mènent au pays natal.
Seuls, quelques obstinés essaient de fêter Noël. Quelques textes et des mélodies à moitié fausses, de vieux chants de Noël, c’est tout. Une lampe de mineur éclaire la grande pièce d’une lumière vacillante. Tellement de mal du pays, tellement de nostalgie y sommeillent ce soir-là.
Tout à coup, la lourde porte à verrou s’ouvre brutalement et le commandement le plus craint des prisonniers de guerre les replonge tous brusquement dans la dure réalité du présent : « Toute la chambrée en rang ! » Probablement encore un appel et l’attente dans le froid pendant des heures…
Les projecteurs des miradors éclairent et surveillent les silhouettes transies de froid qui se sont mises en rang. Les sentinelles et le commandant du camp s’avancent, emmitouflés dans leur manteau et leur bonnet de fourrure. Le commandant demande un traducteur. Celui-ci traduit phrase par phrase en allemand ce que dit le commandant afin que tous puissent comprendre :
« Prisonniers, dans votre patrie, l’Allemagne, les réactionnaires célèbrent aujourd’hui une fête qui s’étend sur deux jours. En Union Soviétique, on n’a pas le temps de célébrer des fêtes. On y travaille pour le bien des prolétaires du monde entier afin que l’heure de leur libération sonne bientôt. C’est pourquoi vous allez chanter maintenant l’Internationale en signe de solidarité avec tous les travailleurs. »
Et le traducteur commence à chanter l’Internationale : « Levez- vous, damnés de cette terre… » Et les mille prisonniers… se taisent. Dans les rangs du fond, un prisonnier entame un autre chant, quelques-uns l’accompagnent, d’abord timidement : « Douce nuit, sainte nuit… », puis tous se mettent à chanter, d’une voix pleine et forte. La première strophe est finie. Le traducteur répète la fin de l’Internationale : « Peuples, entendez les signaux… », mais la strophe suivante de Douce nuit, sainte nuit retentit comme un air de défi. Et ce sont mille hommes qui chantent les dernières paroles. Non, ils les crient, dans cette nuit pleine de mystère : « Le Christ, le Sauveur est là ! Le Christ, le Sauveur est là ! » Cela ressemble à un acte de foi enthousiaste qui s’échappe de la triple clôture de barbelés vers les steppes russes infinies.
Puis règne un silence à couper le souffle. Le commandant pose une question au traducteur. Celui-ci répond d’une voix claire et audible : « C’était l’Internationale chantée sur un air allemand. »
Les dix commandements
1. Tu adoreras Dieu seul.
2. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
3. Tu sanctifieras le dimanche.
4. Tu honoreras ton père et ta mère.
5. Tu ne tueras pas.
6. Tu ne commettras ni impureté ni adultère.
7. Tu ne voleras point.
8. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
10. Tu ne désireras pas les biens de ton prochain.
La vertu de justice consiste à donner à chacun son dû. La justice, c’est donc d’abord de donner à Dieu l’obéissance qui est due à notre Créateur.
Obéir à Dieu, c’est vivre selon ses commandements.
C’est pourquoi, Dieu les a inscrits à grands traits dans le cœur de tout homme. C’est la loi naturelle. De fait, la conscience de tout homme droit l’avertit qu’il n’est pas bien de tuer, de voler, de mentir et de commettre l’adultère. Elle lui rappelle aussi qu’il doit tout à son Créateur et à ses parents.
Si donc les dix commandements obligent tout homme, combien plus les croyants qui voient en eux l’amour bienveillant d’un Père !
Pourquoi Dieu nous a-t-il donné les dix commandements ?
Parce qu’il veut nous conduire à la plénitude de la vie.
La petite lumière bleue
Le 3 février 1959, à 23h12 et dix mille mètres au-dessus de l’Atlantique Nord, le commandant de bord Waldo Lynch jette encore un coup d’œil sur le tableau de bord du Boeing 707. Son copilote Sam Peters étudie une carte. Le commandant Lynch a envie de se dégourdir les jambes ; il pense que le plus dur est passé.
En effet, juste après avoir quitté Paris, ils sont entrés dans une tempête, avec un vent contraire de 120 km/h. Ils viennent de réussir à monter au-dessus de cette zone de forte turbulence et à atteindre dix mille mètres d’altitude.
Le commandant met donc son pilotage automatique en marche, enlève ses écouteurs radio et se lève. Il a quarante-sept ans, il est d’allure sportive, dans la force de l’âge. Il tape sur l’épaule de Sam pour lui faire signe qu’il s’en va un moment.
Le commandant se promène parmi les passagers. Ils ont tous leur ceinture de sécurité attachée ; elle les protège en cas de turbulences. À l’arrière de l’avion, un bébé pleure dans les bras de sa mère. Le commandant Lynch la rassure : « Cela va aller mieux : le petit va pouvoir dormir. »
Ce qui arrive à cet instant précis est difficile à décrire. Il est encore plus difficile de se l’imaginer. Le commandant sent tout à coup l’avion basculer du côté droit. Il est projeté contre les fauteuils. Toutes les lumières s’éteignent. Puis le commandant flotte littéralement pendant deux ou trois secondes dans la cabine. Il se retrouve ensuite allongé par terre, il le pense tout au moins car il est engourdi par le choc. Il s’aperçoit vite qu’il n’est pas plaqué au sol mais au plafond. Une seule explication à cela : le Boeing s’est retourné et tombe sur le dos, comme une pierre. Les cris des centaines de passagers attachés à leur siège couvrent le bruit des moteurs.
Le commandant Lynch a quinze mille heures de vol derrière lui et il réagit en conséquence. Il doit quitter les passagers et rejoindre le plus rapidement possible la cabine de pilotage car il pense qu’il doit être arrivé quelque chose au copilote. Mais comment rejoindre Sam alors que la pesanteur le colle au plafond ?
Lynch déploie des forces effrénées. Il fait des efforts surhumains et parvient à se rapprocher de la cabine en se tirant d’un siège à l’autre. Il entend le vrombissement des réacteurs : ils fonctionnent donc encore. Il a une chance de sauver l’avion ! Mais le temps ! C’est une question de secondes, le commandant le sait. L’avion a déjà dû tomber à 5 ou 6 000 mètres car il est de nouveau en plein orage.
Tout à coup, Lynch sent un nouveau mouvement de l’avion qui s’est retourné et tombe en spirale. Cette fois, le commandant pense que tout est fini. Le Boeing 707 n’est plus qu’une feuille tourbillonnante dans la tempête. Les passagers ne crient plus : ils sont évanouis ou attendent leur mort.
Mais Lynch ne veut pas abandonner. II vient d’atteindre les premières classes, en avant de l’avion. Rassemblant ses dernières forces, il continue à avancer en se tirant d’un siège à l’autre. Soudain tout l’avion se met à trembler. Il va exploser ! C’est la dernière pensée du commandant avant d’être renversé.
Le Boeing ne tombe plus comme une feuille dans le vent mais fonce comme une fusée vers la mer. Le hurlement des réacteurs devient insupportable, toute la cabine est ébranlée. L’avion approche de la vitesse du son. Mais il n’est plus la proie de la tempête, le commandant reprend donc espoir… Combien de secondes lui reste-t-il ? Déployant toujours le même effort surhumain, il réussit à atteindre la cabine du pilotage. Il sent des mains qui le saisissent et le tirent violemment vers l’intérieur de la cabine. Ce sont le navigateur et le mécanicien. Lynch saisit le siège de pilotage et réussit à s’y asseoir. Il a enfin le manche à balai en main. Malgré la nuit et la tempête, il voit sous lui la mer déchaînée. Il évalue la hauteur à 2000 mètres. Mais dans la seconde même où il fait ce calcul, l’avion, lui, a déjà chuté de 300 mètres…
Lynch essaie de relever l’appareil. Il voit alors que le copilote est évanoui. Il crie aux autres : « Aidez-moi ! » Les trois hommes s’accrochent de toutes leurs forces au manche à balai pour essayer de le redresser. Mais dans cette chute verticale à la vitesse du son, ils sont sans cesse rejeté en arrière. Même en unissant leurs forces, ils n’y parviennent pas et l’avion continue son piqué vers la mer déchaînée.
Tout d’un coup, le copilote revient à lui, À quatre ils parviennent enfin à remettre le Boeing en position horizontale. Quelques secondes de plus et l’avion aurait explosé dans l’Atlantique.
Personne n’est blessé. Le tout n’a duré que quatre minutes. Que s’est-il passé ? Après le départ du commandant, le copilote a continué à étudier sa carte. Il n’a pas remarqué la petite lumière bleue qui clignotait sur le tableau de bord, signal d’alarme en cas de non-fonctionnement du pilotage automatique.
Dieu, comme un Père attentif, nous a aussi donné des signaux d’alarme : les dix commandements. Il les a marqués à grands traits dans le cœur de chaque homme. Ne les négligeons pas. Ils peuvent nous éviter beaucoup de malheurs.
Quels sont les trois premiers commandements ?
Pas de faux dieux, pas de prière du bout des lèvres, pas de dimanche sans messe.
Applaudissements pour Staline ! (Pas de faux dieux !)
En Russie, les communistes croyaient que Dieu n’existe pas. Mais les dirigeants communistes, en particulier Lénine et Staline, furent adorés comme des dieux. Des faits à peine croyables ont eu lieu à cette époque.
Alexandre Soljénitsyne raconte l’histoire suivante, dans son livre L’archipel du goulag :
Il y eut un jour un rassemblement politique dans une petite ville près de Moscou. Des personnalités importantes de la ville étaient assises sur le podium.
Des policiers en civil, comme toujours, se trouvaient parmi les gens installés dans la salle. Il y eut beaucoup de discours. Le point culminant du rassemblement fut un discours à la gloire de Staline, le grand dirigeant de la Russie.
L’orateur venait à peine de terminer son discours que, déjà, toute l’assistance se levait et applaudissait avec enthousiasme. Elle applaudissait, et encore, et toujours : trois minutes, quatre minutes ! Chacun savait que la police secrète de Moscou regarde attentivement qui arrête en premier d’applaudir. Et personne ne s’arrêtait, bien sûr. Pendant six, sept, huit minutes. Les personnes âgées avaient des palpitations mais elles ne s’arrêtaient pas non plus. Neuf, dix minutes ! Chacun finit par avoir peur : comment cela allait-il se terminer ? Onze minutes. Le directeur de l’usine de papier de cette petite ville, debout sur le podium, en eut assez. C’était un homme courageux. Il arrêta d’applaudir et s’assit.
Comme par miracle, le silence se fit dans la salle. L’assistance suivit l’exemple du directeur et arrêta d’applaudir. Ce fut le soulagement général.
La semaine suivante, le directeur fut mis sous les verrous. Chef d’accusation : mauvaise administration de ses affaires. Il fut condamné à dix ans de prison.
À la fin de l’audience, le juge lui dit en passant : « La prochaine fois, tâchez de ne pas arrêter d’applaudir le premier s’il s’agit de Staline. »
Bien sûr, les communistes ne sont pas les seuls à vénérer de faux dieux. Nous aussi, nous avons nos faux dieux : nos faux dieux voyants, comme les autos, les films, les vêtements, l’argent. Et nos faux dieux secrets comme la recherche du plaisir, la soif de pouvoir et de réussite.
Que veut dire : pas de prière du bout des lèvres ?
Cela signifie : il faut être sincère quand on parle à Dieu.
Haselbauer
En Bavière, on raconte l’histoire suivante :
Haselbauer était gravement malade et le curé était à ses côtés. Haselbauer se confessa. Le curé dut lui poser quelques questions car Haselbauer connaissait fort bien les péchés de ses voisins mais il avait très mauvaise mémoire quant aux siens.
« Alors, Haselbauer, avez-vous dit chaque jour votre prière depuis votre dernière confession ? demanda le curé.
– Oui ! fut toute la réponse.
– Quelle prière avez-vous dite ?
– Le Notre Père.
– Alors, vous avez dit chaque jour : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » ? constata le curé.
– Oui, c’est ça.
– Alors, poursuivit le curé, vous avez sûrement pardonné à vos ennemis ?
– Oui, c’est ça, mais pas à Hansjörg. Il m’a vraiment trop roulé, celui-là.
– Haselbauer, il n’y a pas d’exception dans ce domaine, et quand vous serez mort, il sera trop tard. »
Haselbauer réfléchit : « Bon, je vais lui pardonner, à lui aussi – au cas où je mourrais. Mais si je vais mieux, alors ça sera comme avant. »
Eh bien, ces petites combines, ça ne marche pas. Quand on parle avec Dieu, il faut être sincère. Il ne suffît pas de prier du bout des lèvres.
Comment sanctifier le dimanche ?
En participant à l’Eucharistie et en aimant nos proches.
Les deux testaments
Cette histoire se passe à Francfort, il y a quelques années déjà. Un homme très riche vient de mourir. Cet homme n’a pas de parents proches. Chacun se demande donc avec curiosité qui va bien pouvoir hériter de ses millions.
L’homme en question laisse deux testaments. Le premier doit être ouvert tout de suite après sa mort, le second après son enterrement seulement… Dans le premier testament, il était écrit : « Je veux être enterré à quatre heures du matin. » Ce vœu quelque peu étrange est exaucé. Seules cinq personnes en deuil suivent le cercueil.
Puis on ouvre le deuxième testament. Il y était écrit : « Je veux que toute ma fortune soit partagée à parts égales entre ceux qui étaient présents à mon enterrement. »
Ces cinq vrais amis ont eu de la chance ! On serait presque tenté de les envier, mais, en fait, nous n’avons pas de raison de le faire : nous avons beaucoup plus de chance encore.
En quoi ? Le dimanche, nous nous réunissons aussi à cause d’un Testament, celui de Jésus qui nous a dit : « Faites ceci en mémoire de moi. »
Beaucoup d’hommes et de femmes trouvent ce Testament bizarre et restent à la maison le dimanche. Mais nous savons que nous recevons bien plus d’un million lorsque nous célébrons l’acte d’amour de Jésus. En effet, lors de la célébration eucharistique, nous recevons la lumière et la force qui nous mènent à la joie éternelle.
Quels sont les quatre commandements suivants ?
Tu respecteras tes parents.
Tu ne tueras pas.
Tu ne commettras pas l’adultère.
Tu ne voleras pas.
La facture de Maman
Le petit Fritz était assis à la table de la cuisine. Il écrivait avec beaucoup d’application dans son cahier. Le bout de sa petite langue pointait entre ses dents.
« Qu’écris-tu donc si consciencieusement ?, demanda la mère de Fritz, debout devant sa cuisinière.
– Je t’écris une facture ! répondit le petit garçon sans se laisser distraire.
– Ah ! ça alors ! Je suis bien curieuse de la voir, dit la mère.
– Tu la verras quand j’aurai fini. »
Après avoir rempli toute la feuille, il la montra à sa mère qui commença à lire à haute voix :
Facture de Fritz. Holzhauser à sa mère
3 x Aller chercher du lait 1,20 F
2 x Nettoyer la cuisine 4,80 F
3 x Essuyer la vaisselle 3,20 F
5 x Nettoyer les chaussures 6,00 F
4 x Mettre le couvert 3,30 F
Total : 18,50 F
La maman sourit après avoir lu cette facture quelque peu particulière. Puis elle prit le crayon :
« Je t’écris la mienne en face, dit-elle.
– Ta facture ? demanda Fritz étonné. Mais tu as fait aussi quelque chose pour moi ?
Oh, un tout petit peu… », dit sa mère. Puis elle écrivit :
Facture de Madame Holzhauser à son fils Fritz
8 ans de cuisine 0,00 F
8 ans de lavage 0,00 F
50 raccommodages de pantalons et de chandails 0,00 F
100 nuits de veille pour maladie 0,00 F
Total : 0,00F
Le garçon lut attentivement la facture de sa mère :
« Mais, maman, pourquoi as-tu écrit partout 0,00 francs ?
Parce qu’une mère fait tout gratuitement pour son enfant, répondit la maman. Mais maintenant, je vais te donner les 18,50 F que tu as gagnés. »
Alors le jeune garçon dit : « Non, maman, je ne veux rien du tout, ta facture devrait être cent fois plus élevée que la mienne. »
Est-ce que l’avortement est un meurtre ?
Oui, car c’est tuer une vie humaine dans le sein de la mère.
Un cas intéressant
Un gynécologue de Tübingen raconte ce cas intéressant :
Une jeune femme vint me voir. Elle était mariée à un professeur et elle le secondait dans son travail. Elle me dit qu’elle était enceinte pour la première fois. Mais elle ne voulait pas garder l’enfant. Elle me demanda si je voulais bien pratiquer un avortement.
« Vous n’avez vraiment pas de quoi élever un enfant ? demandai-je.
– Je ne me suis pas mariée pour avoir des enfants mais pour travailler et faire des recherches avec mon mari.
– Votre mari, dis-je, préférerait peut-être avoir un enfant plutôt qu’une collaboratrice scientifique.
– Je ne crois pas, répondit-elle. Et puis, après tout, cela me regarde et personne d’autre que moi.
– En tout cas, l’avertis-je, vous ne pouvez pas compter sur mon aide. Et si vous vous adressez ailleurs, réfléchissez bien avant de le faire.
– Cela fait longtemps que j’ai bien réfléchi. »
Nous nous regardâmes un bon moment sans nous parler. Puis je lui dis très tranquillement : « Alors, vous voulez tuer votre propre enfant, vous êtes une criminelle ! » La jeune femme blêmit de rage. Elle se leva brusquement, saisit son sac et claqua la porte derrière elle.
Sept mois plus tard, je reçus un coup de téléphone. C’était la même femme : « Vous pourrez m’aider lors de mon accouchement ? » Je ne pus m’empêcher de sourire.
Bien sûr, je l’ai aidée. Et elle ne trouva pas assez de mots de remerciement pour « ce bonheur maternel insoupçonné. »
Elle accoucha encore de trois enfants et m’envoya pendant des années des remerciements et des fleurs.
Que signifie « commettre l’adultère » ?
Cela veut dire devenir infidèle entre époux en prenant une autre femme ou un autre homme.
Tu n ‘es pas ma maman !
Nanette, une jeune femme française, nous raconte son histoire :
Je suis née dans une petite ville de la côte Atlantique. J’ai partagé une enfance heureuse avec mes deux frère et sœur. Nous aimions beaucoup nos parents.
Lorsque j’eus neuf ans, nous fûmes tous les trois envoyés en vacances à la campagne, chez mon grand-père. Huit jours plus tard, ma mère passa. Elle n’entra pas dans la maison, mais vint nous voir en cachette dans le jardin et nous dit : « Votre père ne veut pas que je vous parle. » Nous fûmes très impressionnés.
Plus tard, nous apprîmes que maman avait quitté la maison ce jour-là. Et après des années seulement, j’appris pourquoi cela était arrivé : maman reprochait à papa d’avoir des relations avec d’autres femmes.
Puis les vacances prirent fin. Papa vint nous chercher. Je me souviens parfaitement de ce moment précis. Il se tenait debout à côté de sa voiture. Nous portions nos valises et nos sacs. Une femme se tenait à côté de papa. Soudain il nous dit :
« Venez, les enfants, et dites bonjour à votre nouvelle maman ! »
Je refusai de la saluer. Mon père dit : « Oh, ça lui passera ! » Mais je ne pouvais vraiment pas comprendre pourquoi je n’avais plus ma maman.
Et je fus comme frappée par la foudre lorsqu’on me dit :
« Tes parents se sont séparés, tu as une nouvelle maman. » Cela ne « passait » vraiment pas, c’était trop.
Mon attitude de rejet provoqua la haine de ma belle-mère. Je ne voulais pas lui obéir. Je devins de plus en plus amère et je me renfermai tous les jours davantage. Mon caractère changea.
Ma belle-mère et mon père étaient très amoureux. Le soir, ils allaient souvent au théâtre ou à l’opéra. Nous restions à la maison, nous avions peur et nous nous disions : « Tu vois, ils ne nous aiment pas ! »
Un jour, ma belle-mère – une fois de plus – m’avait frappée sans raison. Elle me cria : « Tu n’es pas mon enfant ! » Je répondis moi aussi en criant : « Tu n’es pas ma maman ! »
Les années passèrent. La situation empira de jour en jour. Puis ce fut la grande dispute.
Ma petite sœur était sensible à l’eau chaude. Ma belle-mère lui avait préparé un bain très chaud. J’y plongeai mon coude et dis : « L’eau est trop chaude ! » Ma belle-mère m’entendit et dit à ma petite sœur : « Allez, tout de suite dans le bain ! » Elle la saisit et la mit de force dans le bain. Ma petite sœur cria de douleur. Je fus prise de rage. Je me jetai sur ma belle-mère. Elle tomba en arrière et sa tête heurta le placard. Elle tomba évanouie par terre.
Je fus paralysée de peur et je pensai : « Tu l’as tuée. » Prise de panique, je quittai la maison en courant aussi vite que possible.
À la gare, je sautai dans un train et allai sans payer jusqu’au terminus : Bordeaux.
Et me voilà là-bas. Des centaines de personnes se hâtaient dans toutes les directions. Je devais avoir l’air vraiment perdue car un jeune homme fringant m’adressa soudain la parole. Il avait tout de suite deviné ma situation désespérée. Il me promit une belle vie et beaucoup d’argent si je travaillais pour lui. Je n’avais pas le choix car je ne voulais en aucun cas retourner à la maison. Et c’est ainsi que je fis le trottoir dès l’âge de quatorze ans.
Prendre ce qui appartient à un autre, est-ce la seule façon de voler ?
Non, c’est aussi voler que de garder pour soi tout seul ce qui pourrait servir à beaucoup d’autres.
Le scandale de la faim
La journaliste française France Lesprit raconte ce qu’elle a vécu dans un des pays les plus pauvres du monde : le Bangladesh.
« Il y a quelques jours, j’ai vu un garçon couché par terre sur le trottoir, à côté de lui une gamelle vide. Cela n’avait rien d’extraordinaire car ici, à Dacca, il y a des centaines de pauvres comme lui. Mais ce jeune garçon râlait parmi les détritus. Des corbeaux sautillaient autour de lui ; ils attendaient manifestement sa mort.
Ses côtes saillantes étaient recouvertes d’abcès, ses bras squelettiques étaient couverts de blessures purulentes.
Je me suis penchée pour lui donner quelque chose à manger. Il a refusé. Il en était arrivé à un point où tout vous est égal, où l’on ne veut même plus manger.
Je l’ai transporté dans le foyer pour mourants de Mère Teresa. Mais c’était déjà trop tard. Le lendemain, il est mort sans une plainte. »
Nous devons nous demander pourquoi ce jeune garçon de Dacca a dû mourir. Pourquoi au moins deux cents malheureux doivent mourir de faim chaque jour dans cette capitale ? Oui, pourquoi des millions d’hommes, de femmes et d’enfants doivent continuer à mourir de faim dans le monde ? A ce propos, une petite histoire.
Des parents avaient cinq enfants. Ils voulaient partir tous les deux en voyage. Ils dirent à l’aîné de leurs fils : « Voici cent francs pour acheter la nourriture. »
Les parents partis, l’aîné des garçons prit quatre-vingts francs pour lui et dit à ses quatre frères et sœurs : « Je vais faire une randonnée à vélo avec mes amis, mais vous avez aussi besoin d’argent : voici les vingt francs qui restent. »
Ce garçon n’est-il pas un voleur s’il garde pour lui tout seul ce qui appartient en fait aux cinq enfants ?
Mais nous, les nantis des pays riches, nous n’avons pas le droit de lui jeter la pierre. Car bien que nous ne représentions que 20 % de la population mondiale, nous consommons 80 % des richesses de la terre.
Quels sont les trois derniers commandements ?
Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas. Tu n’envieras pas ton prochain.
Et les petits mensonges ?
Lorsque, dans un pays, tous les hommes sont soldats, il n’y a plus de travailleurs.
En 1943, Hitler eut besoin de travailleurs étrangers pour ses usines de munitions.
Il fit donc venir en Allemagne beaucoup d’hommes jeunes des territoires occupés. Des commandos de soldats « tombaient » sur des quartiers résidentiels entiers et emmenaient de force tous les jeunes.
Un Hollandais de dix-sept ans, Peter vanWoerden, raconte comment se passa l’une de ces rafles dans sa famille :
Un problème inquiétait tout particulièrement mes sœurs. Que devaient-elles répondre si les soldats arrivaient par surprise et que nous leurs frères, nous nous cachions dans la maison ?
Dire la vérité ou bien raconter des histoires à l’ennemi pour nous sauver ? Nous n’étions pas d’accord sur l’attitude à adopter. Notre mère assistait, silencieuse, à nos discussions et attendait que nous ayons fini. Puis elle nous répétait sans se lasser :
« Ne dites jamais rien qui ne soit pas vrai, et faites confiance à Dieu. »
Quelques jours plus tard arriva ce que nous craignions. Ma plus jeune sœur Cocky était en train de nettoyer sa chambre à l’étage. Lorsqu’elle ouvrit sa fenêtre pour secouer son torchon à poussière, elle vit des soldats aller de maison en maison dans le quartier. Très inquiète, elle descendit les escaliers en courant et atterrit littéralement dans mes bras : « Peter, vite ! Cache-toi ! Ils sont là ! »
Nous avions creusé un trou sous le plancher de notre cuisine (elle n’était pas sur cave), au cas où les soldats débarqueraient chez nous. Cocky, toute tremblante, souleva les planches et m’aida à me cacher. Puis elle les remit minutieusement à leur place et les recouvrit d’un petit tapis. Elle mit la table sur le tapis et posa sur elle une grande nappe qui pendait de tous les côtés.
Et déjà j’entendais le lourd piétinement des bottes au-dessus de moi. Mon cœur battait si fort que j’avais l’impression qu’il allait me trahir. J’entendis une voix d’homme demander dans un mauvais hollandais : « Y a-t-il des hommes jeunes dans la maison ? » C’était donc la question à propos de laquelle nous n’avions jamais pu nous mettre d’accord. Qu’allait dire Cocky ? La vérité ? Alors ils m’emmèneraient. Mais un non n’était tout de même pas un mensonge !
« Seigneur, aide-là ! » priai-je.
-Y a-t-il des hommes jeunes dans la maison, oui ou non ? répéta le soldat.
– Oui. monsieur, dit la voix claire de ma petite sœur, sous la table. »
Le soldat souleva précipitamment la grande nappe et regarda dessous. Rien ! Au même instant, ma petite sœur éclata bruyamment de rire. L’homme rougit car il venait manifestement de se faire « berner » par une jeune adolescente. Décontenancé, il interrompit ses recherches.
Que signifie : « ne pas convoiter » ?
Cela veut dire ne pas avoir de désirs impurs dans son cœur.
La convoitise précède l’acte
C’était en Italie, en 1902. Deux familles habitaient l’une à côté de l’autre, à la campagne : la famille Goretti et la famille Serenelli.
La mama Goretti était veuve et devait travailler dur avec son fils de seize ans dans l’exploitation agricole pour pouvoir nourrir les cinq enfants plus jeunes. Elle y parvenait seulement parce que Maria, âgée de douze ans, s’était chargée des travaux ménagers. C’était une jolie petite fille, consciencieuse et gaie.
Chez les Serenelli, c’était différent. Le père était alcoolique et s’était très peu occupé de l’éducation de son fils de vingt ans, Alessandro. Celui-ci était un bon à rien qui ne travaillait pas et qui perdait son temps à lire de mauvais journaux. Il convoitait beaucoup sa jolie petite voisine.
Un jour, il dit à Maria de venir dans sa chambre. Il essaya de la convaincre de se donner à lui. Il devint de plus en plus pressant. Mais Maria résista. Le jeune homme, terriblement déçu, se mit en colère. Il saisit son couteau et la menaça. Maria se mit à crier pour appeler au secours. Il perdit alors tout contrôle de lui-même et se jeta sur elle. Il lui enfonça plusieurs coups de couteau dans le corps.
Maria mourut quelques jours plus tard à l’hôpital dans d’horribles souffrances. Avant de mourir, elle pardonna à son meurtrier.
En 1950, le pape Pie XII la canonisa.
En quoi est-elle une sainte ? Elle a fait la volonté de Dieu. Car Dieu veut que l’homme et la femme ne soient UN que dans le mariage.
Les sacrements
Nous avons tous besoin de signes visibles. Comment croire, par exemple, que l’on est aimé si l’on ne reçoit jamais un signe de cet amour, ne serait-ce qu’un sourire ?
Dieu a donné aux hommes de foi des signes de son amour vivifiant. Ce sont avant tout les sept sacrements. Par eux, nous recevons la plénitude de la vie divine. Cette vie de l’âme s’épanouit comme la vie du corps.
Le baptême, c’est la naissance.
La confirmation, c’est la croissance.
L’Eucharistie, c’est la nourriture.
La pénitence, c’est le remède.
Le sacrement des malades, c’est la cure.
Le sacrement de l’ordre nous donne des « bergers. »
Et par le mariage le peuple de Dieu s’agrandit.
Qu’est-ce que le baptême ?
C’est une purification qui nous fait enfants de Dieu.
Helen Keller
À un an et demi, Helen Keller perdit la vue et l’ouïe. Elle devint donc aveugle, sourde et muette. Comment cette pauvre enfant qui était en quelque sorte une morte vivante put-elle devenir une grande femme ouverte aux événements du monde ?
Helen Keller le raconte elle-même :
« Lorsque j’eus six ans, mon désir ardent de pouvoir me faire comprendre grandit de jour en jour. Comme je n’arrivais pas à rompre ce mur du silence autour de moi, j’étais de plus en plus coléreuse. J’avais l’impression que des mains invisibles me tenaient enfermée et je faisais tics efforts désespérés pour me libérer.
La plupart du temps, j’étais complètement épuisée après mes accès de colère et je me réfugiais en pleurant dans les bras de ma mère. Mes parents se faisaient beaucoup de soucis ; ils ne savaient que faire pour m’aider. Après avoir longtemps cherché, ils trouvèrent enfin une solution.
Le jour le plus important de ma vie fut celui où ma maîtresse, mademoiselle Sullivan, arriva chez nous. C’était le 3 mars 1887, trois mois avant mes sept ans. Le 4 mars au matin, mademoiselle Sullivan m’emmena dans sa chambre et me donna une petite poupée. Je jouai un moment avec elle. Puis ma maîtresse épela lentement : d-o-1-1 (poupée) dans le creux de ma main. Ce jeu de doigts m’intéressa tout de suite et je commençai à l’imiter. Lorsque je réussis enfin à imiter exactement les lettres, je rougis de joie et de fierté. Je descendis les escaliers en courant pour aller voir ma mère, lui tendis ma main et lui montrai les lettres que je venais d’apprendre. A l’époque, je ne savais pas encore que j’épelais un mot, je ne savais même pas l’existence des mots.
Je bougeais simplement mes doigts par jeu d’imitation. J’appris de cette façon à épeler de nombreux mots.
Mais le miracle ne se produisit que quelques semaines plus tard. Voici comment cela arriva : nous nous étions disputées à propos des mots m-u-g et w-a-t-e-r. Mademoiselle Sullivan avait essayé de m’inculquer que m-u-g signifiait gobelet et que w-a-t-e-r- signifiait eau. Mais je m’obstinais à confondre les deux. Désespérée, elle finit par changer de sujet.
Elle m’apporta mon chapeau ; nous allions donc partir nous promener dans la chaleur du soleil. Cette pensée me fit courir et sauter de joie. Nous prîmes le chemin du puits. Le parfum des lilas nous accompagnait. Quelqu’un tirait de l’eau, et ma maîtresse me tint la main sous le flot d’eau fraîche. Pendant qu’elle coulait abondamment sur l’une de mes mains, elle m’épela le mot w-a-t-e-r dans l’autre main, d’abord doucement, puis vite. Je ne bougeais pas et suivais, très attentive, les mouvements de ses doigts.
Tout d’un coup, je tressaillis, comme touchée par un éclair, celui de la « reconnaissance » ; le mystère de la langue venait de se dévoiler à moi : chaque chose avait un nom !
Je savais maintenant que l’eau était cette merveilleuse chose fraîche qui coulait sur ma main. Ce mot vivant éveilla mon âme à la vie, lui fit don de la lumière, de l’espérance et de la joie. Il la libéra de ses chaînes !
Je quittai le puits, avide d’apprendre. Chaque chose portait un nom. J’appris ce jour-là beaucoup de mots nouveaux. Je ne me souviens pas de tous, mais je sais que « mother », « father », « sister » (mère, père, sœur) en faisaient partie, des mots qui firent éclore la vie en moi. »
Helen Keller a été libérée de son carcan étroit par l’eau, par cette eau qui lui coula sur la main. « Ce mot vivant, écrit-elle, éveilla mon âme à la vie, lui fit don de lumière, d’espérance et de joie, et la libéra de ses chaînes ! »
C’est ainsi que l’eau du baptême éveille notre âme à une vie nouvelle, divine, et nous libère des chaînes du péché originel.
Comment la confirmation rend-elle le chrétien plus ferme ?
L’évêque en lui imposant les mains le remplit de l’Esprit Saint.
Confirmation signifie consolidation
Sous le régime communiste, tous les moyens étaient bons pour détruire la foi en Dieu. Voici la lettre d’une collégienne croyante de Lituanie :
Lorsque j’étais en cinquième, le professeur principal voulait me forcer à m’inscrire, aux « Pionniers » (Mouvement de jeunesse communiste). Voyant que j’hésitais, il me dit :
« Si tu ne veux pas t’inscrire cette année, tu seras obligée de le faire l’année prochaine. »
Mais je continuais à m’y opposer, et il commença à me menacer de mauvaises notes et d’autres punitions. Je dus bientôt me rendre à l’évidence : il avait parlé sérieusement car mes notes baissèrent chez quelques professeurs.
Un jour, je rencontrai mon professeur dans la rue. Il me demanda :
« Où vas-tu ? »
Je répondis : « Je vais à l’église. »
Il me dit alors d’un ton menaçant : « Mais arrête enfin de courir ainsi à l’église ! »
Un autre jour, on distribua en classe un questionnaire. Les questions étaient les suivantes : « Vas-tu à l’église ? », « Qui t’envoie à l’église ? », etc.
Je répondis à ces questions de la façon suivante : « Oui, je vais à l’église », « Je vais à l’église et c’est moi qui le veux. »
Peu de temps après, le professeur me fit venir et me dit :
« Alors, tu continues à aller à l’église ! Eh bien, vas-y ! Mais écoute bien : si les gens du Gouvernement viennent te demander si tu vas à l’église et si tu es croyante, tu dois répondre non ! »
Je parlai de cela avec mes parents. Ils me donnèrent le conseil de ne jamais renier Dieu.
En classe, nous dûmes régulièrement écrire des rédactions hostiles à la religion. Et c’est ainsi que mon professeur me tourmenta jusqu’à la lin de l’année scolaire, à cause de ma foi en Dieu.
Voilà ce que raconta cette jeune fille courageuse. Un chrétien ne doit pas seulement accepter de croire. II doit aussi grandir dans la foi afin de pouvoir rester ferme face à la persécution et à la moquerie. C’est pourquoi il est bon que le jeune chrétien reçoive la force de l’Esprit de Dieu dans le sacrement de confirmation.
Réf. Untergrundzeitschrift Chronik der katholischen Kirche in Litauen, Âusgabe Nr. 22, 1976.
Que se passe-t-il pendant la célébration de l’Eucharistie ?
Le sacrifice du Christ est offert au Père pour notre salut.
La vérité dépasse la fiction
C’était pendant la seconde guerre mondiale. Dans toute l’Europe, des Juifs étaient chassés, déportés, assassinés.
Des résistants juifs essayaient désespérément de libérer leurs frères emprisonnés. Ils lançaient des attaques nocturnes contre les redoutables S.S.
Wittenberg était le chef de ces résistants courageux, à Wilna. Les S.S. avaient mis sa tête à prix.
Un jour, il fut pris. Mais les S.S. s’étaient réjouis trop tôt. Wittenberg put fuir et se cacher dans le quartier juif de Wilna.
Lorsque le général S.S. entendit cela, il ordonna de cerner tout le quartier juif et de le garder sous haute surveillance. Puis il fit transmettre un message aux Juifs : ou bien ils livrent Wittenberg, ou bien tous les habitants du quartier seront emmenés dans les camps de la mort.
Une peur lourde planait sur ces êtres malheureux. Mais Wittenberg la leur enleva. Car il ne voulait pas qu’ils meurent pour lui. Et la nouvelle circula de bouche en bouche : « Il se rend de son plein gré ! »
Ce moment venu, la population juive se rangea le long des trottoirs de la rue qui menait aux portes de la ville : d’un côté, les jeunes « combattants », de l’autre côté les hommes âgés, les femmes et les enfants. Wittenberg désigna son successeur, un certain Kovner, et lui donna son pistolet.
Puis il marcha, au milieu de la rue vide jusqu’aux portes de la ville, sans regarder ni à droite ni à gauche. Il allait, courageux, à la rencontre d’une mort horrible.
Jésus, lui aussi, accepta librement une mort atroce. Il le fit pour sauver tous les hommes. Ce sacrifice unique de ce Dieu fait Homme a une valeur infinie. Au cours de chaque messe, ce sacrifice unique de la Croix est offert de nouveau pour nos péchés.
Réf. Nach Herbert Kranz, Der Engel schreibt’s auf.
Comment devons-nous recevoir Jésus dans la sainte communion ?
Avec une foi profonde qui attend tout de lui.
La confiance récompensée
Un jour, l’empereur Napoléon alla dans une auberge. Il n’était accompagné que de son aide de camp, Duroc. Il ne voulait pas être reconnu et portait des vêtements tout à fait ordinaires.
Après le repas, la vieille aubergiste apporta la facture de 14F. Duroc prit sa bourse et pâlit, car elle était vide…
L’empereur sourit, condescendant, et dit :
« Ne vous faites pas de souci, je vais payer. »
Il fouilla dans ses poches, mais il dut, hélas ! constater que lui non plus n’avait pas d’argent. Que faire ? Duroc fit la proposition suivante à l’aubergiste :
« Nous avons oublié notre argent, mais je reviens dans moins d’une heure et je paierai tout. »
La vieille femme ne voulut rien entendre. Elle menaça tout de suite les deux hommes d’aller chercher les gendarmes s’ils ne payaient pas sur-le-champ.
Le garçon d’auberge qui avait suivi la discussion eut pitié des deux hommes. Il dit à l’aubergiste :
« Mais cela peut arriver à tout le monde d’oublier son argent ! Ne prévenez pas les gendarmes. Je vais payer les 14 F à leur place. Les deux hommes me paraissent sincères. »
Ils purent ainsi quitter l’auberge. Duroc revint rapidement et demanda à l’aubergiste :
« Combien avez-vous dépensé pour acheter cette auberge ?
– Trente mille francs », répondit la vieille femme.
Duroc sortit son portefeuille et posa trente mille francs sur la table. Puis il dit : « Sur ordre de mon maître l’empereur, j’offre cette auberge à cet homme qui nous a aidés alors que nous étions dans le besoin. »
Nous pouvons nous demander pourquoi l’aubergiste a perdu son auberge, et pourquoi le garçon d’auberge fut ainsi récompensé. Les deux ont reçu le même hôte de marque et lui ont donné à manger. Mais il y avait pourtant une grande différence entre eux : le garçon d’auberge fit confiance à cet hôte discret, mais l’aubergiste, elle, ne lui fit pas confiance.
Certains donnent leur confiance à Jésus, d’autres pas. Les uns attendent tout de lui, les autres sont indifférents et n’attendent rien.
Nous avons oublié notre argent, mais…
Nous aussi, les chrétiens, nous recevons Jésus comme hôte discret dans une hostie. Pourquoi certains s’améliorent-ils après avoir communié et d’autres pas ?
Comment pouvons-nous nous libérer de nos péchés ?
En les regrettant et en les confessant.
Le diamant volé
On raconte une curieuse histoire sur un roi d’Aragon, en Espagne. Un jour, le roi alla voir un bijoutier avec ses courtisans. Pendant qu’il s’entretenait avec le commerçant, les courtisans regardaient les bijoux. Ils quittèrent ensuite la bijouterie. Mais le bijoutier les rejoignit très vite : il était dans tous ses états. Il dit au roi qu’un diamant de grande valeur lui manquait. Le roi demanda à ses courtisans de retourner à la bijouterie. Il demanda au bijoutier d’aller chercher une cruche remplie de sel. Puis il pria chaque personne de sa suite de plonger son poing dans la cruche et d’en ressortir ensuite la main ouverte.
Tous les courtisans firent ce que le roi demandait. Puis le sel fut vidé sur la table. Et, tiens, tiens, le diamant apparut.
Ce roi était bienveillant. Il avait voulu donner au voleur la possibilité de se racheter de sa malhonnêteté sans honte publique.
Le Christ agit ainsi avec nous. Tant que nous sommes sur terre, nous pouvons toujours recevoir son pardon dans toute la discrétion de la confession.
Pourquoi devons-nous nous repentir de nos péchés ?
Parce que nos péchés ont offensé Dieu qui est bonté infinie.
Vol avec assassinat
Au Portugal, en 1910. Minuit vient de sonner à la tour de l’église paroissiale. Le père Ribeira est sur le point de quitter son bureau lorsqu’on sonne. Probablement un grand malade, pense-t-il.
Le père ouvre la porte du presbytère et voit un homme, le chapeau enfoncé sur le visage. Celui-ci lui dit d’un ton décidé :
« Je voudrais me confesser. »
Malgré l’heure tardive, le curé répond : « Soit ! »
Le prêtre fait entrer l’homme au chapeau. Celui-ci avoue alors : « Je m’accuse d’avoir commis un vol et d’avoir assassiné ma victime ! »
Le prêtre le regarde d’un air grave :
« Le regrettez-vous ?
– Oh oui ! J’ai commis une faute : je n’aurais pas dû le faire près de la gare, car quelqu’un m’a vu et a déjà prévenu la police.
– Mais que vous ayez profondément offensé Dieu, cela ne vous dérange pas ? lui dit le prêtre sur un ton de reproche.
– Absolument pas !
– Alors, je ne peux pas vous donner l’absolution.
– Cela ne fait rien. Maintenant, le principal est que vous vous taisiez, car vous n’avez pas le droit de parler de mon crime : c’est le secret de la confession. Et par ailleurs, je vous laisse ici mon pistolet, et le porte-monnaie volé. Je viendrai les rechercher plus tard. Adios ! »
L’homme saute par la fenêtre dans le jardin et disparaît dans la nuit.
À peine a-t-il disparu que l’on sonne avec force à la porte. Le père Ribeira a juste le temps de faire disparaître le porte-monnaie et le pistolet sous ses papiers avant d’ouvrir la porte.
Quelques gendarmes en uniforme entrent et l’officier de police, sans même saluer le prêtre, dit :
« Un homme a été agressé et assassiné, il y a une heure, près de la gare. Grâce à nos chiens, nous avons suivi jusqu’ici la trace de l’assassin. Qu’avez-vous à dire ?
– Je ne suis au courant de rien, balbutie le prêtre, d’une pâleur cadavérique.
– Vous semblez avoir mauvaise conscience, dit le lieutenant d’une voix hargneuse. Nous devons fouiller votre maison. »
Ils ne mettent pas longtemps à découvrir l’argent et l’arme.
« Comment l’argent et l’arme sont-ils arrivés jusqu’ici ? demande le gendarme.
– Je ne peux rien vous dire, répond le prêtre.
– Ne perdons pas notre temps ! Vous êtes arrêté. »
Le père Ribeira fut condamné aux travaux forcés à perpétuité pour vol et assassinat.
Six ans plus tard, pendant la première guerre mondiale, un soldat grièvement blessé est amené d’urgence dans un hôpital militaire. Il demande un prêtre. Après s’être confessé, il reconnaît devant trois officiers avoir été le voleur-assassin à la place duquel le père Ribeira avait été condamné.
C’est ainsi que le père fut libéré, après six ans de travaux forcés : on avait la preuve de son innocence.
Quel bienfait reçoit-on dans le sacrement des malades ?
L’onction d’huile fortifie l’âme et – si Dieu le veut – le corps.
Je renie la franc-maçonnerie
« Pas de prêtre auprès des mourants ! »
Telle était la nouvelle règle des francs-maçons. Cet ordre était très anticlérical au siècle dernier.
Verhaegen, le grand maître de la franc-maçonnerie belge, avait bien combiné son affaire. Afin que dorénavant aucun franc-maçon malade ne puisse recevoir la visite d’un prêtre, trois autres francs- maçons devaient rester auprès de son lit.
Verhaegen voulut ensuite faire appliquer cette nouvelle règle en France et en Italie. Il voyagea donc de ville en ville et fit des conférences qui eurent beaucoup de succès.
Lorsqu’il revint d’Italie, lors du rude hiver de 1862, il dut passer les cols des Alpes. Il finit par atteindre le Mont-Cenis, après avoir pris des diligences, des traîneaux, et être monté à dos de mulet.
Il entra dans une auberge, à moitié mort de froid et commanda une boisson chaude. Une jeune fille lui apporta un grog. Verhaegen, n’en pouvant plus d’attendre, l’avala d’un trait. Il poussa un cri et se leva précipitamment : il n’avait pas réalisé que la boisson était bouillante. Il venait de se brûler la bouche, la gorge et l’estomac.
Il rejoignit Bruxelles le plus vite possible. Il fit tout de suite venir à son chevet les meilleurs médecins de la ville. Mais ceux-ci secouèrent pensivement la tête : ils ne pouvaient plus rien pour lui.
Deux jours après son retour à Bruxelles, Verhaegen perdit tout espoir de guérison. En effet, trois francs-maçons prirent place ce jour-là autour de son lit – alors qu’il ne les avait pas appelés. Ils le veillaient, le visage impénétrable, sans dire un mot.
Soudain, Verhaegen fut pris de dégoût pour cette « religion des ténèbres » et envahi d’une immense nostalgie pour la religion de son enfance : pour l’Église du Christ.
Il fit appeler un prêtre, mais les trois « sentinelles » avaient déjà fermé la porte à clef, et le prêtre ne put entrer. C’est ainsi que Verhaegen mourut sans absolution et sans le secours spirituel du sacrement des malades.
Le jour de l’enterrement de Verhaegen, on trouva des traces de son combat solitaire contre la mort : il avait inscrit avec ses ongles sur le papier du mur : « Je regrette et je renie la franc-maçonnerie ! » Signé : Verhaegen.
Comment le prêtre peut-il continuer l’œuvre de salut du Christ ?
Par la parole, le sacrement et par l’exemple.
Au bord du canal du Danube
En 1950, les Russes voulaient construire un immense canal. Celui-ci devait devenir une voie d’eau supplémentaire entre le Danube et la Mer Noire. Les communistes en étaient très fiers. Deux cent mille prisonniers y travaillaient. Chaque homme devait creuser huit mètres cube de terre par jour, avec de simples outils. Sous les coups des surveillants, ils remontaient de pleines brouettes le long des pentes abruptes. En hiver, la température tombait à -25°.
Et pourtant, il se passa aussi de très belles choses dans cet enfer.
Un jeune prêtre catholique, le père Cristea, était particulièrement haï du « mouchard. »
Ce dernier lui demanda :
« Pourquoi as-tu les yeux si souvent fermés ? Tu pries peut- être ? J’exige que tu me dises la vérité. Crois-tu toujours en Dieu ? »
Un « oui » de la part du père Cristea entraînerait des coups de fouet – si ce n’est pas plus. Mais il n’hésita pas :
« Oui, je crois en Dieu ! »
Le mouchard se précipita chez le lieutenant. Celui-ci arriva et ordonna au père de se présenter à lui. Cristea était maigre et à bout de forces. Il tremblait de tout son corps dans ses vêtements en guenilles. Le lieutenant était bien nourri, emmitouflé dans son manteau, bien au chaud sous son bonnet de fourrure.
« J’ai entendu dire que vous croyez en Dieu », dit-il.
Cristea répondit :
« Lorsque je fus ordonné, je savais que beaucoup de prêtres avaient payé leur foi de leur vie. À chaque fois que je m’approchais de l’autel, je promettais à Dieu la chose suivante : Je te sers maintenant dans de beaux ornements, mais si l’on devait un jour me jeter en prison, je continuerais toujours à te servir. Lieutenant, la prison n’est pas un argument contre la foi. Je crois en Dieu, »
Le silence qui suivit fut seulement troublé par le frémissement du vent. Le lieutenant semblait chercher ses mots, puis il dit enfin :
« Vous êtes aussi pour le pape ? »
Cristca répondit :
« Depuis saint Pierre, il y a toujours eu un pape et il y en aura toujours un, jusqu’à ce que Jésus revienne. Oui, je suis pour le pape. »
Le père Cristea fut mis au cachot pendant une semaine. Il pouvait seulement s’y tenir debout, il ne pouvait pas y dormir. Mais il refusa toujours et encore de renier sa foi. Il fut emmené. Depuis ce jour-là, personne n’a plus entendu parler du père Cristea.
Réf. Nach Richard Wurmbrand, In Gottes Untergrund.
Quel est l’effet de l’échange des consentements dans le sacrement du mariage ?
L’homme et la femme sont unis par un lien indissoluble pour fonder une famille.
« Mors sola »
Katharina Jagello était l’épouse du duc de Finlande, Wasa. Lorsque celui-ci fut condamné au cachot à perpétuité pour haute trahison, elle demanda au roi de Suède, Erich, la permission de partager cette incarcération avec son mari.
Le roi, horrifié, essaya de l’en dissuader :
« Savez-vous que votre mari ne verra plus la lumière du jour ?
– Je sais, Majesté !
– Et savez-vous aussi qu’il ne sera plus traité comme un duc mais comme un homme coupable de haute trahison ?
– Oui, je sais ! Mais qu’il soit innocent ou qu’il soit coupable, il n’en reste pas moins mon mari.
– Après tout ce qui s’est passé, plus rien ne vous lie à lui. Vous êtes de nouveau libre ! »
Katharina ôta son alliance de son doigt et la tendit au roi en disant :
« Lisez, Majesté ! »
Il y avait seulement deux mots latins gravés : « Mors sola » : seule la mort peut nous séparer !
Katharina alla avec son mari en prison et partagea pendant dix-sept ans ses souffrances et toutes les privations de l’incarcération. Puis le roi Erich mourut et le mari de Katharina fut libéré.
À quoi reconnaît-on que l’amour est sincère ?
Au fait qu’il recherche le vrai bonheur de l’autre.
Un cœur d’or
Un vieux juge plein d’expérience faisait sa promenade du soir. Il rencontra un jeune ami dans le parc de la ville :
« Bonjour, Paul, dit le vieux monsieur. J’ai entendu dire que tu allais bientôt te marier. C’est bien. Dis-moi comment est ta future épouse ?
– Ah ! c’est une fille splendide, dit le jeune homme. Elle est belle comme le jour ! »
Le juge sortit un petit carnet de sa poche et inscrivit un zéro. « Et encore ?
– Elle est aussi très sensée. » Le juge écrivit un zéro de plus. « En automne, elle aura un emploi bien rémunéré. » Encore un zéro, et ainsi de suite, jusqu’au sixième zéro. « Par ailleurs, ajouta Paul, ma fiancée a un cœur d’or. J’ai souvent remarqué qu’elle est toujours prête à aider. »
Le juge écrivit alors un « 1 » devant les six zéros et ferma son petit carnet. Puis il serra cordialement la main du jeune homme : « Mes félicitations, Paul ! Ta fiancée vaut un million ! Avec une femme pareille, tu peux te lancer pour la vie ! »