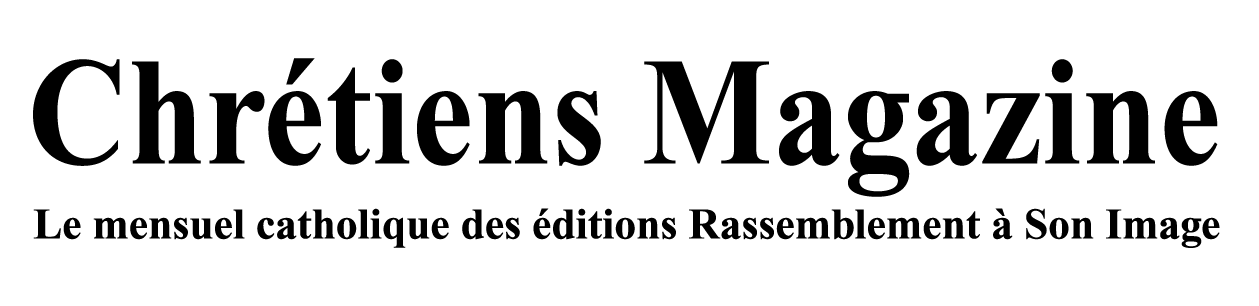Lorsque, dans les années 1920, le frère Marie-Albert Leseur reçoit l’ordination sacerdotale, l’étonnement ne vient pas de la vocation tardive de ce Dominicain déjà âgé, mais parce que cette vocation a été obtenue, ainsi que la conversion de cet incroyant convaincu, par les prières de sa femme Elisabeth, décédée d’un cancer en 1914.
Elisabeth Arrighi naît à Paris le 16 octobre 1866, première de cinq enfants. Son père, d’origine Corse, est avocat. Elisabeth hérite de lui une nature généreuse, gaie et accueillante, de sa mère une vive intelligence et une mémoire exceptionnelle. Malgré ses fréquents déménagements autour de Paris, la famille Arrighi est un pôle intellectuel où se côtoient des artistes, des savants, des philosophes. Mais, autant que ses capacités intellectuelles, se développe chez la fillette l’aspect religieux. Elle a onze ans quand elle se rend pour la première fois au catéchisme afin de préparer sa première communion: « J’étais bien embarrassée, alors j’ai fait tout bas une petite prière à la sainte Vierge et je n’ai pas tardé à me mettre à l’aise ». Elle s’examine sans découragement, mais sans complaisance: « Mon principal défaut à moi, c’est l’esprit de contradiction. Lorsqu’on dit une chose, je dis le contraire ». Elle est également taquine et très entêtée: « Je ne veux jamais avouer que j’ai tort. Je supplie le bon Dieu de m’aider pour que, lorsque j’aurai commis une faute, je l’avoue aussitôt. » Elle communie le 15 mai 1879 avec une grande joie: « Je n’étais plus seule, j’étais avec Notre-Seigneur. Je ne pouvais pas parler, j’étais trop heureuse. » J’écoutais le bon Dieu qui parlait à mon âme. Dans cette ferveur, elle change sa manière d’étudier: « Sitôt que l’on me faisait une observation, je cherchais à l’écarter; je travaillais mollement. Mon Dieu, aidez-moi à vaincre ma légèreté, à devenir sérieuse, travailleuse, attentive, dévouée. »
À vingt ans, dans les soirées mondaines, Elisabeth ne passe pas inaperçue: elle est charmante et distinguée, sa culture est étendue, son intelligence ouverte et prompte, son caractère gai. Le jeune Félix Leseur, étudiant en médecine, remarque « son joli rire, sa fraîcheur et sa franchise ; nous avions les mêmes goûts ». Le 31 juillet 1889, à 22 ans, Elisabeth l’épouse: J’ai trouvé en Félix tout ce que je désirais. Mais ce mari qu’elle aime tendrement va s’employer à détruire sa foi. Félix, au début de leur mariage, s’était déclaré « très respectueux de la foi et de la religion catholiques. Comment étais-je devenu, de sceptique, antireligieux? La neutralité est un mythe ou une duperie ». Peu à peu, il devient jaloux des croyances de sa femme. En septembre, Elisabeth souffre d’une péritonite que les médecins ne peuvent opérer et dont elle ne guérira jamais complètement. Elle se rétablit doucement et commence avec son mari une série de voyages qui les enchantent tous les deux. Il en profite alors pour l’entraîner dans un tourbillon de mondanités; d’autre part, comme elle est avide de connaître et d’accroître sa culture, Félix lui propose d’étudier le latin et le russe et lui fournit des livres « pleins de génie, certes, mais d’un génie anarchique et destructeur. En 1896 et 1897, Félix voit le succès de son œuvre détestable »: Elisabeth ne prie plus et cesse de pratiquer. Plus tard, Félix frémira devant sa responsabilité dans cette crise intérieure: « Quand je pense à quels dangers j’ai exposé Elisabeth en brisant chez elle le seul point d’appui, le seul secours qui soit! » Un jour, en lisant un livre attaquant le christianisme, Elisabeth est frappée par l’indigence du fond et la fragilité des arguments: dans une salutaire réaction, elle revient aux sources ainsi contestées, à l’Évangile. Félix est furieux, mais rien n’arrêtera plus « cette œuvre admirable de la conversion intérieure, provoquée, guidée, accompagnée par Dieu seul ». Cette foi retrouvée va inspirer toutes ses conversations: « Il ne faut pas être un génie pour défendre sa foi! » et toutes ses actions, l’organisation de sa vie, dans une discrétion et un respect absolu des convictions athées de son mari.
Elle fait sienne la devise dominicaine: « Orare et laborare », prier et travailler. La mort de sa sœur en 1905 et le retour de ses souffrances abdominales l’invitent à » réformer sa vie « : « Puisque je ne peux mener entièrement la vie que j’aurais rêvée, il faut que je rende meilleure et plus féconde, pour Dieu et pour les âmes, celle qui m’est destinée ». Elle demande la grâce de devenir plus tendre, plus forte, plus paisible. Son désir est d’être toute à Dieu et « en même temps, de me donner davantage à ceux que j’aime et à tous ceux que la Providence a mis ou mettra sur ma route ». Ses symptômes s’aggravant, on lui prescrit le repos et l’immobilité: « Je vais donc mener une vie de recluse qui ne me déplaît pas ». Elisabeth consacre ainsi de longs moments à la méditation, à l’oraison, à la lecture de livres de spiritualité, « sans pourtant négliger aucun devoir, sans rien perdre de son charme et de sa gaieté foncière ». En 1911, elle est opérée à la suite de la découverte d’une tumeur au sein. Elle offre cette épreuve pour la conversion de Félix: « Laissez-moi, Seigneur, déposer en votre cœur mes souffrances, mes désirs et mes prières ». Pour Elisabeth, la foi est un don de Dieu, si gratuit, si excellent qu’il doit rayonner dans toute sa vie. Ce don est accordé à chaque homme sans aucun mérite de sa part, aussi est-elle opposée à toute querelle, à toute division, à tout parti: « Moi, je suis anti-anti! » Elle réserve chaque jour, dans son emploi du temps, l’heure et demie d’oraison où elle refait ses forces: « Avant d’agir, s’établir dans la paix, fortifier sa volonté par la prière, et ensuite, se mettre à l’œuvre humblement, virilement, joyeusement ». Elle sourit aux descriptions de mortifications excessives et conseille de rechercher plutôt l' » esprit de mortification « : « Accepter les souffrances dans le secret, sans rien faire qui puisse attirer l’attention et en redoublant, au contraire, d’affabilité et de douceur ». Jamais on ne la voit inoccupée; même quand elle est alitée, elle sait utiliser ce temps en ce qu’elle nomme « la science des moments perdus ». Elle n’a pas d’enfant, mais son cœur maternel donne des conseils aux jeunes mères: « Avec vos enfants, sachez vouloir aussi complètement que vous les aimez. Tenez fermement sur un point jusqu’à ce que vous ayez obtenu un résultat, puis vous passerez à un autre point ». Sa crise de foi la rend particulièrement proche des incroyants: « Ceux qui n’ont pas traversé ces moments d’accablement ne connaissent qu’une partie de la souffrance humaine ». Elle oublie ses fatigues, ses épreuves pour aller à la recherche des âmes blessées: « Nous ne passons pas un jour sans rencontrer une détresse du corps ou de l’âme, une tristesse ou une pauvreté ». Elle s’interdit de juger: « J’ai trop compris, en me jugeant moi-même, combien les autres ont droit à l’indulgence ». Son grand désir est la conversion de Félix; pourtant, « jamais femme n’a moins importuné son mari, ne l’a moins pressé de penser comme elle ».
En juillet 1913, Elisabeth doit s’aliter: maux de tête, violents vertiges, vomissements signalent le cancer qui se généralise en elle. Elle supporte ses souffrances avec une patience et une égalité d’humeur qui forcent l’admiration de ses proches et le respect de Félix qui ne la quitte pas. Elle décline rapidement, au point qu’on la croit condamnée: « Je n’existais plus, sans une pensée, dans une sorte de coma ». Mais en août se produit une spectaculaire rémission alors qu’Elisabeth achève une neuvaine adressée à une petite Carmélite morte seize ans plus tôt, sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus. Durant cinq semaines, elle se remet à travailler, à écrire, à reprendre ses occupations. En novembre, tous les symptômes réapparaissent peu à peu. Les périodes de crise sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées. Quand la souffrance lui laisse un peu de répit, elle s’en étonne « comme d’une chose anormale ». Les douleurs de tête provoquent des crises impressionnantes qui s’accompagnent de convulsions, de tremblements, d’angoisses et la laissent épuisée, « brisée mais courageuse, réconfortante même et enjouée le plus souvent », s’excusant des soins que son état réclame. Elle accepte tout, n’exige rien: « Personne ne fut plus facile à soigner ». Son état nauséeux justifierait des désirs de nourriture qu’elle ne formule pas. Ceux qui la visitent se trouvent plongés dans « un bain de sérénité ». Elle offre au mal qui la ronge « une résistance physique extraordinaire soutenue par une résistance morale plus grande encore ». Le 27 avril, elle tend les bras vers Félix pour un ultime adieu avant de sombrer dans un coma où on la voit encore souffrir: elle se plaint, gémit, dévorée de fièvre, torturée par la soif sans rien pouvoir absorber. Elle meurt dans les bras de son mari le 3 mai 1914. Après sa mort, son visage prend une expression souriante et sereine. Elle est enterrée le 6 mai sans que son corps ait manifesté la moindre altération. Félix, pour la première fois, se demanda alors s’il y avait quelque chose en dehors du monde matériel. Un an plus tard, il communia. Devenu dominicain et prêtre, il se dévoua à la cause d’Elisabeth et continua, à travers une abondante correspondante, l’œuvre de compassion, d’écoute et d’accueil de « cet être véritablement exceptionnel ».